Faire un concours de souffrances n’a aucun sens. Ce qu’a vécu quelqu’un est uniquement relatif à lui-même. Ce qui peut se passer ailleurs ne diminue aucunement sur ce que lui peut vivre ou avoir vécu, ni ne mérite de le rejeter.
Catégorie : Politique et société
-
« Les maux s’additionnent toujours les uns aux autres. Ils ne se compensent ni ne s’annulent entre eux. »
Je croyais l’avoir déjà gravé ici, désormais ce sera fait.
Je l’avais effectivement déjà écrit en mars :
Il ne sert à rien de comparer les violences. Les unes ne justifient jamais celles des autres. Les violences ne s’annulent pas l’une l’autre, elle s’additionnent.
Ça fonctionne avec n’importe quels préjudices, n’importe quelles actions malveillantes, n’importe quelles trahisons, …
Les maux ne s’annulent pas les uns les autres, ils s’additionnent entre eux.
-
Petite revue de presse pour faire peur
Ou pour prendre conscience et chercher comment (ré)agir. Édition du 4 juillet 2019, après celle d’hier.
« Avant, personne n’aurait jugé « radical » de sauver quelqu’un en train de se noyer »
François, Médecin sans Frontière, via Libération« On est dans un renversement [de valeurs]. Avant, on n’aurait pas considéré comme « radical » de sauver quelqu’un qui est en train de se noyer. Quiconque fait preuve de solidarité est aujourd’hui considéré comme un criminel. […] »
Libération, 4 juillet 2019 via @libe sur Twitter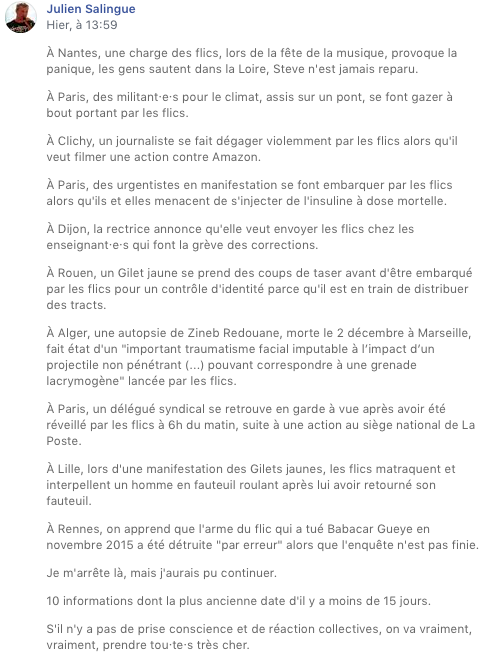
-
Petite revue de presse pour faire peur
Ou pour prendre conscience et chercher comment (ré)agir. Édition du 3 juillet 2019.
Je ne sais pas vous mais je commence à ne plus rigoler du tout.
On parle là de droits fondamentaux, et de problèmes qui ne sont plus des petits dérapages individuels.
On parle de problèmes structurels sur toute la chaîne de la représentation publique, du policier sur le terrain jusqu’au préfet et au ministre.
On parle de ce qui ne peut plus être autre chose que l’expression de directives et d’une volonté. Même le simple laisser faire conscient n’est plus crédible.
-
Droite, gauche, tout ça
Nous ne sommes pas un parti d’extrême droite
Un ou une responsable du Rassemblement National, récemment à la radioLe journaliste a répliqué que si. J’ai eu la même réaction dans ma tête mais y réfléchir c’est loin d’être aussi évident.
Factuellement, sur mes trois critères intuitifs pour définir l’axe droite / gauche, le RN me parait bien à droite, mais nettement moins que LR. L’étiquette d’extrême droite ne correspond pas à une droite extrême et ça me dérange quelque part.
Droite, gauche, extrême, tout ça n’est pas si simpliste et ça me fait me poser des questions.
C’est quoi la droite ?
Je vous ai demandé ce qui qualifiait pour vous l’axe droite gauche. Je reformule ici quelques réponses :
Gauche : Utiliser la dette pour investir pour tous (Keynes)
Droite : Pas de dette, pas d’investissement car ruissellement (Smith
https://twitter.com/tractataire/status/114650327993486951Gauche : On veut changer le monde, créer une société nouvelle que l’on croit meilleure
Droite : On accepte le monde tel qu’il est, ou on souhaite le faire revenir à un état passé
https://twitter.com/bumblebee_fr/status/1146506586623545345Gauche : Humanisme et solidarité
Droite : Conservatisme et responsabilité individuelle
https://twitter.com/zemoko/status/114650483640335564Gauche : Tend à rechercher une société juste, quitte à bouleverser l’ordre établi
Droite : Tend à préserver l’ordre établi, les traditions, au nom de « valeurs » historiques
https://mamot.fr/@petitevieille/10237931506933507Gauche : Idée forte de l’égalité des individus. Aucun individu n’a par nature une valeur moindre (que ce soit sa vie, sa santé, etc…), ne mérite moins qu’un autre
Droite : Présupposé du genre « X, par ce qu’il est/fait/ ne fait pas, n’est pas assez méritant pour tel truc »
(compte privé)Gauche : Un État qui laisse les gens libre/progressiste sur les aspects sociétaux, mais control freak sur les aspects économiques / entreprise.
Droite : Un État qui laisse libre sur les aspects économiques / entreprise, mais conservateur / control freak sur les question de société
https://twitter.com/Modj0r/status/1146525377340346368Gauche : Se préoccupe du bien être de tous
Droite : Se préoccupe du succès individuel
https://twitter.com/anthony_ricaud/status/1146545870084685836Gauche : Croit en l’individu. La grandeur de la France passe par le bonheur des français
Droite : Croit en un État fort. Le bonheur des français passe par la grandeur de la France
https://twitter.com/nicolassing/status/1146531514311745538 et suivantGauche : Avancée collective
Droite : Mérite individuel
(compte privé)Gauche : La réussite du groupe permet la survie des individus
Droite : Les réussites des individus permettent la survie du groupe
https://twitter.com/simplementNat/status/1146698809575202817Tout ça n’est pas si loin de mes trois critères personnels :
Gauche : Responsabilité collective, protection des individus, progression des libertés civiles
Droite : Responsabilité individuelle, protection de l’économie, conservation ou retour à l’ordre moral
On me dit que la catégorisation droite / gauche n’a plus lieu d’être mais finalement les réponses données forment un tout assez cohérent.
Si certains critères semblent très différents (économiques, sociaux, espérance de changement) et que tout n’est pas aussi binaires, tout ça semble quand même assez lié.
Une des réponses qu’on m’a fait a l’avantage de trouver une généricité à tout ça :
Gauche : Pense plus le sujet comme un être social et identifie alors des structures d’échelles et des liens constitutifs à la fois des sujets et de la société, dans un projet global (on parle de holisme)
Droite : S’identifie à la notion d’ordre ; place cet enjeu dans un cadre moral généralement fort, voir coercitif, dont le centre est le sujet (identité, citoyenneté, responsabilité, croyance, mérite, etc.).
(réponse privée)Mais alors les extrêmes ?
Si l’extrême gauche se retrouve toujours aussi plus ou moins dans la gauche extrême, ce n’est pas vrai pour l’extrême droite actuelle
On y ajoute un autre axe. Intuitivement je lis des questions de nationalisme ou globalement de constitution d’un « nous » et d’un « eux » — peu importe qui est le « nous » et qui est le « eux ».
On y trouve rapidement l’autoritarisme comme réponse pour policer, chasser ou exclure le « eux », la défiance aux autres, la radicalisation, le complotisme ; et du populisme pour légitimer cette posture autoritaire.
À droite ça prend la forme du nationalisme voire de la xénophobie, avec une réponse qui va de la militarisation et répression jusqu’au racisme et au fascisme.
Extrême centre
Mon problème avec ce double critère c’est qu’il n’est pas simple. Rien qu’aujourd’hui, trois articles de presse me font très peur.
Autoritarisme, militarisation, répression, protection d’un nous État + police contre un eux manifestants et étrangers, au risque de dépasser allègrement les droits fondamentaux.
Et pourtant, nous n’avons pas un gouvernement d’extrême droite. Personne ici ne le qualifierait comme tel.
Bref, quelque chose manque encore dans mes classifications, ou alors nous refusons de voir ce qui est en face de nous.
Certains parlent d’extrême centre. Si la classification d’extrême n’est pas liée au positionnement sur l’axe droite – gauche, ce n’est peut être pas une mauvaise dénomination.
-
Petit mémo pour juger des peines
Des questions à se poser
Est-ce que la peine et ses conséquences (emploi, famille, etc.)…
… permet au prévenu d’intégrer le fait qu’il a outrepassé la loi et la gravité de ses actes ? (*)
… dissuade efficacement d’une réitération ?
… permet la réinsertion du prévenu ?
… risque de faire croire aux tiers que la loi est sans conséquences ou que ces conséquences sont acceptables au point de l’outrepasser ?
(* celle là est difficile, trop faible il n’y aura pas prise de conscience profonde mais une peine trop forte peut être aussi peu efficace, au point d’être perçue comme injuste on risque aussi de bloquer le processus — ou alors il faut aller encore plus loin pour réussir à passer la période de rejet/contestation)
Et d’autres à ne pas se poser
Est-ce que la peine et ses conséquences (emploi, famille, etc.)…
… est la même que celle du voisin pour des mêmes faits ? Parce que les conséquences, la personnalité, le contexte, la conscience, l’intention, la probabilité de réinsertion, la personnalité, tout ça est forcément toujours différent.
… est cohérente vis-a-vis de celle du voisin pour des faits qui sont à priori moins graves ? Parce que justement la peine est déterminée en fonction de beaucoup plus que les faits ou la peine maximale.
… est plus lourde que le préjudice créé ? Parce que la prison ou l’amende ne réparent pas le préjudice, l’objectif n’est pas le même et qu’on a mis fin au oeil pour oeil dent pour dent.
Et bien entendu
Tout dépend du dossier, des débats, des personnalités, pas des résumés dans la presse.
-
Dégressivité
Je m’agace de cette dégressivité des indemnités chômage pour les hauts revenus. Tout ça n’est que démagogie, pour donner l’impression de mettre aussi à contribution les plus riches.
En réalité, si on vise bien les plus hauts revenus — pas les grands patrons hein… on parle des cadres classiques — on parle de mettre à contribution ceux qui sont en rade, au chômage, pas ceux qui s’en sortent ou qui ont de l’aisance de patrimoine.
On parle d’un palier à 4 500 € bruts mensuels, soit 3 540 € nets. L’indemnisation chômage est à 57% soit 2 435 € bruts, 2 155 € nets. Si on applique une réduction de 30 % on tombe à 1 500 €. Ce n’est pas rien mais on imagine assez aisément des loyers familiaux à Paris qui sont de cet ordre de grandeur, et donc des charges fixes plus importantes que ça. Ça va poser problème, peut-être à des familles qui ne sont pas les plus pauvres mais ça va poser problème.
Bref, on va pénaliser ceux qui ont un accident de vie pour favoriser le pouvoir d’achat de ceux qui n’en ont pas. On a beau parler des hauts revenus, cette logique me gêne toujours.
Si vraiment on veut faire de la redistribution sociale — ce qui déjà est un changement de paradigme par rapport au principe de l’assurance chômage — on pouvait avoir une cotisation progressive avec les revenus. Ça aurait pris sur ceux qui le peuvent plutôt que sur ceux qui sont en carafe. Ça serait peut-être juste moins bien passé auprès de l’électorat de la majorité, taper sur les chômeurs est moins risqué.
La grande question c’est toujours pourquoi ?
Pour les inciter à reprendre un travail
C’est la justification officielle mais c’est de la fumisterie. On peut imaginer que certains seraient tentés de souffler quelques mois après un licenciement mais la dégressivité n’apparait qu’après six mois. Ce n’est donc pas ça qui est visé.
Non seulement il y a moins de cadres au chômage mais, si on ne compte pas les séniors, ils le sont aussi moins longtemps que la moyenne.
Ceux que ça va toucher c’est ceux dans des situations spécifiques : hors zone urbaine dans un département qui ne recrute que peu, avec une qualification ou un rôle qui fait que les postes sont rares et qu’il faut attendre qu’un se libère, et ceux détruits par le licenciement qui ont besoin d’un peu de temps pour se reconstruire.
Si on parle de cadres en plein emploi, prendre un an de chômage volontaire c’est tuer sa carrière. Je ne vois personne faire ça volontairement, indépendamment du financier. Les études sur la dégressivité montrent d’ailleurs que ça n’aurait une influence qu’à la marge.
En fait la dernière chose qu’on veut socialement c’est que ces cadres prennent en urgence un emploi sous-qualifié pour éviter la dégressivité. Ils prendraient cet emploi à une personne moins qualifiée qui lui aura bien plus de mal à trouver du chômage. En parallèle le cadre aura plus de mal à prendre le temps de faire sa vraie recherche d’emploi par la suite, et l’entreprise devra réembaucher quelqu’un d’autre dès que le cadre aura trouvé un travail en adéquation avec sa qualification. C’est perdant pour tout le monde, que ce soit humainement ou économiquement.
Parce que c’est le plein emploi pour les cadres
C’est quoi le plein emploi ? Je vais faire concret : 4% de chômeurs c’est 1 personne sur 25. Sur une classe de collège de 35 élèves dont un quart est dans une famille monoparentale, ça fait 2 à 3 parents qui galèrent au chômage, et là on ne parle que des catégories A, pas de tous ceux qui cherchent un emploi ou sont en situation difficile
1 sur 25 au chômage, 3 parents par classe. Ça remet un peu en perspective la notion de « plein emploi » qu’on y attache, non ?
Il se trouve qu’une société en plein emploi aura toujours un % de chômeur non nul, parce qu’il faut gérer les transitions. Maintenant ça ne veut pas dire qu’un % faible correspond à du plein emploi. Ça ne dit rien de la facilité de ce % à retrouver un emploi. Ça peut être facile (beaucoup de monde qui tourne vite) ou très difficile (peu de monde qui ne tourne pas vite du tout).
Regarder au travers des moyennes est toujours une arnaque. Ça dit qu’en moyenne, la catégorie ciblée est à 4% de chômage mais ce n’est certainement pas homogène. Il peut y avoir certaines catégories de postes ou d’emplois qui sont à 2% et d’autres qui sont à 10% de chômage. On va appliquer la dégressivité indistinctement.
Si l’ouvrier spécialisé en automobile qui voit son usine fermer aura du mal à retrouver un emploi parce qu’il n’y avait qu’une seule usine automobile dans la région, ça sera pareil pour le cadre spécialisé en automobile. Les deux devront chercher, se former. La rotation des postes pour le cadre sera probablement d’autant plus faible.
Considérer que parce que les plus hauts revenus n’ont que 4% de chômage, s’ils y restent c’est forcément de leur faute, c’est juste une escroquerie.
Parce que les hauts revenus coûtes cher au chômage, ça fera des économies
En fait non, ou peu. Les cadres sont rentables. Vu qu’ils sont moins au chômage et moins longtemps, ils cotisent plus qu’ils ne coûtent. Ce sont eux qui financent le chômage des non-cadres. Sachant que le chômage est une assurance et pas une aide sociale redistributive, c’est assez difficile de considérer qu’il faudrait baisser leurs prestations à eux uniquement.
On parle de 250 millions. C’est à la fois énorme en valeur absolue et peu significatif dans le contexte. On parle de 3,5 milliards d’économie. 14 fois plus. L’enjeu d’économie n’était pas là… sauf s’il s’agit d’initier un mouvement pour ensuite appliquer la dégressivité des allocations plus largement.
Pourquoi alors ?
Pour dire qu’on s’attaque aussi au plus riches, parce que sans ça les autres changements défavorables à tous les chômeurs et particulièrement aux plus précaires feraient l’actualité.
Pour le faire sans pour autant rompre la logique de culpabilisation de ceux qui sont hors parcours, sans retirer la notion de « pouvoir d’achat de ceux qui réussissent », cette magnifique idéologique qui tue le modèle social de redistribution.
Il ne s’agit pas de pleurer sur ceux qui gagnent le plus et de jouer Les misérables. Il s’agit juste de dire que si on peut faire les faire participer à hauteur de leurs possibilités, si ce n’est pas un problème que ces cotisations financent majoritairement d’autres besoins que les leurs propres, ça implique quand même que dans le rare cas ou eux aussi ont un accident de vie, ils aient les mêmes droits assurantiels que les autres.
Ensuite je fais des calculs, je parle à froid, rationnellement. La réalité c’est qu’au chômage en situation psychologique difficile, le rationnel ne compte pas toujours. Cette dégressivité sélective peut être sacrément destructrice, parce que la psyché humaine ne dépend pas de la dernière fiche de salaire avant de passer au chômage, tout simplement.
Alors quoi ?
Alors on peut faire payer les entreprises qui abusent trop du système. Il y a une amorce avec le bonus/malus des emplois précaires et je m’en réjouis.
On éventuellement au moins discuter de cotisations progressives avec les revenus, même si ça fait déjà sortir de la logique assurantielle.
On peut aussi imaginer un délai de carence dépendant des revenus. Je n’aime pas le principe mais il est clair que celui qui a des hauts revenus a moins rapidement besoin de soutien que celui qui a des bas revenus. Si la situation dure, les indemnités pleines et entières seront par contre indispensables.
Ma dernière proposition est l’exact contraire de ce que fait le gouvernement en ce moment. Ce n’est pas un hasard, c’est savoir si on est dans l’idéologie de culpabilisation (si tu es au chômage c’est de ta faute parce que tu ne cherches pas un emploi assez fort) ou dans l’aide (si ça devient critique, on sera là pour que tu ne coules pas plus bas). La droite appelle ça responsabilisation et assistanat. Question de vocabulaire mais je préfère ne pas oublier que le troisième terme de notre devise est fraternité.
-
« Conforme à un ensemble de critères sociaux et environnementaux »
Je fais le tour des propositions des différents groupes pour les Européennes.
Je filtre en ne retenant que ce qui concerne vraiment l’Europe. Je rage chaque fois élection en voyant combien même les partis qui se disent pro-européens font majoritairement campagne sur des sujets nationaux.
J’ai à mon grand étonnement trouvé pas mal de choses intéressantes côté PCF. J’ai aussi trouvé une réplique magnifique de leur candidat :
— « Vous l’utilisez Facebook, vous utilisez Google […] Vous pourriez ne pas collaborer avec ces géants
PCF sur twitter, extrait de LCP
— « Regardez, des tas d’éditorialistes du Figaro qui dénoncent le fonctionnement de la sécurité sociale, utilisent la sécurité sociale donc si vous voulez qu’on joue à ce petit jeu là […]
La proposition qui m’intéresse est pour une fois de la France Insoumise.
« Tout produit pénétrant dans le marché commun est conforme à un ensemble de critères sociaux et environnementaux.
La France Insoumise, sur TwitterÇa n’a l’air de rien mais si je devais soutenir deux pistes de travail sur l’Europe, elle ferait partie des deux (l’autre serait une refonte démocratique dans les institutions).
Aujourd’hui on parle de salaire minimum en Europe et on parle d’intention écologique, mais ça reste d’impact quasiment nul. Toute avancée se heurtera forcément au mur de la concurrence mondiale.
Dans cette vision on a l’impression que le social et l’écologie se font forcément au détriment de notre intérêt. Malheureusement, s’il y a une chose que la gouvernance européenne actuelle ne semble pas prête à faire, c’est bien handicaper notre positionnement économique.
Si je dois voir une vraie solution, c’est forcément en imposant que toute la planète respecte les mêmes règles.
Ça semble impossible mais il n’y a aucune raison sérieuse.
On impose déjà à tous les produits et services vendus en Europe de respecter certaines règles, généralement économiques et de sécurité. Ces règles prennent parfois en compte les impacts des produits après leur vente (sécurité, toxicité dans le temps, recyclage, etc.).
On ne peut pas refuser l’entrée des produits construits dans des pays avec des normes sociales et écologiques basses. Par contre je ne vois rien qui empêcherait de règlementer les ventes en Europe en fonction de normes écologiques et sociales des produits — peu importe leur provenance — soit en considérant une interdiction des produits et services ne respectant pas un minimum, soit avec une taxe progressive sur ce critère.
Le vrai enjeu c’est de considérer toute la vie du produit, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à sa vie de déchets. On ne compte donc pas que ce qui est réalisé sur le sol européen mais tout ce qui concourt à la vente ou son achat sur notre sol, directement ou indirectement.
Bref, on pourrait, avec un peu de volonté.
On peut commencer par des normes excessivement basses, qui finalement sont respectées quasiment partout en Europe. On éviterait donc trop de débat interne.
Voilà d’un coup que les normes écologiques et sociales des pays européens deviendraient un avantage économique sur leur marché (nous les respectons déjà, nous réduisons l’avantage concurrentiel de réaliser les mêmes biens et services sans prendre en compte les impacts écologiques et sociaux de façon délocalise).
Ça favoriseraient en même temps la montée sociale et écologique des autres pays au lieu de favoriser leur exploitation (ça coute encore probablement moins cher de produire ailleurs dans le monde, mais ça leur impose quand même d’élever leurs pratiques s’ils veulent participer, générant une concurrence vers le haut).
Charge à nous ensuite de monter ces normes au fur et à mesure, année après année.
De quoi je parle ?
- Le nombre de kilomètre parcouru sur toute la vie du produit, matières premières incluses
- Le carbone généré
- Un revenu minimum absolu, relatif au prix des denrées et services primaires locaux, ou relatif au revenu moyen, pour tous les salariés et prestataires concernés, directs et indirects
- Pour les mêmes travailleurs, des garanties sur l’accès aux soins, les filets de sécurité, la non discrimination, la liberté syndicale, etc.
- L’impact écologique de production en terme de rejets toxiques, de traitement, de protection des milieux naturels
- L’impact écologique en terme de recyclage
- La durée de vie moyenne du produit ou la période garantie
- La réparabilité du produit
Ce ne sont que des grands sujets, c’est forcément très flou juste pour exemple, mais si nous arrivons à même imaginer avancer sur un socle vraiment minimum-minimum qui se convertisse en loi européenne sur tous les produits et services vendus en Europe, ça serait énorme.
En pratique chacun auto-certifie ses propres actions et se charge de demander les mêmes certifications de la part de tous ses fournisseurs, qui eux-même devront faire de même pour s’auto-certifier.
Évidemment il y aura plein de faux dans la chaine. Je ne demande même pas d’obligation de résultat, juste d’obligation de moyens et d’attention.
À chacun de mettre en œuvre des mesures raisonnables et crédibles pour s’assurer de la véracité et de la vraisemblance des garanties de ses fournisseurs, et être responsable en cas de problème manifeste, de problème connu, ou de manque de contrôle en cas de défaillance à répétition.
C’est peu, mais c’est juste énorme par rapport à l’(in)existant et ça ouvre la voie à des poursuites en justice pour les maillons européens qui ne jouent pas assez le jeu sur le contrôle et les garanties sur toute leur chaîne amont.
Suis-je totalement à l’ouest ? Ça me parait à la fois faisable techniquement, respectueux des traités internationaux pourtant très libéraux, bénéfique à notre économie, et bénéfique à notre situation sociale et écologique comme à celle des pays qui sont aujourd’hui nos poubelles à ce point de vue.
J’ai pu louper plein de choses, y compris de l’évident, mais du coup je veux bien vos lumières.
-
Démocratie — Accepter de ne pas la vouloir
Il est acceptable de souhaiter ne pas toujours suivre la volonté du peuple. Ce peut-être que la population ne comprend pas, qu’elle n’a pas l’expertise, qu’il est impossible de toujours demander son avis au peuple sur chaque décision, qu’il y aura toujours une majorité de mécontents quelle que soit la décision prise, que les avis sont trop divers pour trouver un consensus… Choisissez vos raisons ou ajoutez les vôtres. L’exemple qui revient le plus est l’abolition de la peine de mort à une date où le peuple aurait probablement voté contre.
Bref, ceci est un choix politique et philosophique tout à fait défendable. C’est même partiellement le choix de nos régimes représentatifs occidentaux. Lors de la révolution française démocratie était presque un gros mot, au même titre que démagogie aujourd’hui.
Par contre, si vous assumez ce choix de ne pas toujours suivre le peuple en tout point et en tout moment, acceptez d’entendre que les décisions qui en découlent ne sont pas démocratiques, que le régime qui le permet n’est pas pleinement démocratique.
Peut-être qu’une démocratie pure et absolue n’est pas réaliste, ou même pas souhaitable. Ce n’est pas horrible. Il faut juste l’assumer, et savoir mettre les mots dessus. Ça permet de prendre du recul pour savoir quoi améliorer, ou pour décider de la direction à prendre.
-
Démocratie — Quelques pensées
Je place là quelques notes de discussions récentes et moins récentes.
Démocratie : Régime politique, système de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par le peuple, par l’ensemble des citoyens
Définition via le CNRTLChoix arbitraire de définition, explicité ailleurs, mais je n’ai pas vu de source d’autorité avec un sens vraiment différent.
Reprendre le sens des mots est essentiel si on veut avoir le moindre recul.
Si on réduit la démocratie à la volonté du peuple, on n’aurait pas mis fin à la peine de mort
On l’a fait. C’était une bonne chose. Ça n’en fait pas pour autant une décision démocratique (à l’époque) pour autant si une part majoritaire de la population était contre.
Une bonne décision n’est pas forcément démocratique. Une décision démocratique n’est pas forcément bonne.
Il faut juste accepter de faire descendre le concept de démocratie de son piédestal. Oui dans une pure démocratie on aurait probablement mis plus de temps à arrêter la peine de mort en France.
Peut-être que la réponse est que nous ne voulons pas d’une démocratie parfaite, tout simplement.
Si on réduit la démocratie à la volonté du peuple, ça peut donner l’Allemagne Nazie, l’antisémisitme, [etc].
Je n’ai pas l’expertise sur cette époque pour prétendre savoir quelle est la part de volonté du peuple et quelle est la part de prise de pouvoir.
Pour autant oui. Le concept de démocratie n’est aucunement lié à un quelconque sujet éthique ou moral. Que le peuple ait le pouvoir implique qu’il puisse tout à fait décider des pires horreurs, de répressions et régressions sans précédent. Il peut aussi toutefois décider de bienveillance, de respect des libertés, de progression sociale et de bonheur collectif.
C’est d’ailleurs probablement vrai quel que soit le régime, démocratie ou pas. La politique c’est décider ce qu’on fait du pouvoir qu’on a.
Attention à ne pas confondre démocratie et dictature de la majorité
Dans toutes les définitions que j’ai trouvé, on parle de pouvoir au peuple sans définir comment on détermine cette volonté dans un peuple qui n’a pas qu’une seule opinion.
Dans notre vision élective, on traduit ça par une majorité de 50% + 1 mais ce n’est pas limitatif. On pourrait très bien imaginer une majorité aux 2/3, ou même un consensus qui n’implique pas d’accord mais juste une absence de rejet.
Non la démocratie n’est pas la dictature de la majorité dans sa définition. Savoir comment mettre en place un système démocratique concret qui ne puisse pas tourner en dictature de la majorité est une vraie question intéressante et je n’ai pas la réponse.
Je note toutefois deux points :
1– Notre système actuel, bien qu’ayant fait des compromis, ne nous garantit rien non plus contre la dictature de la majorité. Pire, notre système permet la dictature de la plus grande minorité, ce qui est encore moins glorieux.
2– S’il est difficile de savoir où s’arrête la démocratie et où commence la dictature de la majorité, il est toutefois simple de dire que s’il n’y a pas d’assentiment d’au moins la majorité, les décisions prises ne peuvent être qualifiées de démocratique. Dit autrement : L’assentiment de la majorité n’est pas forcément suffisant mais il est clairement nécessaire.
Il y a eu vote démocratique
Le vote est un outil, la démocratie est un régime politique. Le vote peut nous aider à créer un système de gouvernance qui nous mènera à un régime démocratique (ou à un régime qui cherche à l’être), mais il n’y est ni nécessaire ni suffisant.
Démonstration par l’absurde : Il est tout à fait possible d’imaginer une monarchie élective, avec un roi ayant les pleins pouvoirs jusqu’à sa mort, et une élection à sa mort pour désigner un nouveau roi. Ce ne serait pas une démocratie (le peuple n’aurait pas le pouvoir) mais il y aurait bien élection.
La démonstration n’est d’ailleurs pas si absurde que ça parce que si nos systèmes de gouvernance se limitaient à élire des représentants, nous serions effectivement dans une suite de petites dictatures électives le temps d’un mandat. Ce qui nous fait avancer un peu vers la notion de démocratie c’est la séparation des pouvoirs, les contre-pouvoirs, la constitution et tout ce qui permet au peuple de garder le contrôle d’une façon ou d’une autre sur les gens qu’il a élu.
Malheureusement constitution et contre-pouvoirs ne sont là aussi que des outils, pas suffisants en eux-mêmes (surtout si la constitution peut-être changée par une assemblée sans en référer au peuple et si les contre-pouvoirs sont eux-mêmes actionnables uniquement par les représentants).
Nous avons une constitution, des élections, les droits de l’Homme, des institutions, n’est-ce pas ce qui fait de nous une démocratie ?
Outre les réponses sur la constitution et les élections qui ne sont que des outils et pas constitutifs d’un régime particulier, et la question des droits de l’Homme qui représentent plus une question de morale qu’une question de régime politique, l’ensemble décrit une organisation où le pouvoir est partagé, règlementé.
La définition d’un telle organisation c’est la république. République et démocratie tendent à se rejoindre dans nos esprits mais ils n’ont pas à l’être. La république qualifie sa structure, la démocratie qualifie sa finalité et qui a le contrôle dans la structure.
Ne confondons pas démocratie et démagogie
Cette phrase me gêne parce qu’elle est trop souvent employée pour dire « ne suivons pas la volonté du peuple ».
Démagogie :
A. Exercice du pouvoir par des factions populaires ou par leurs meneurs, avec les abus qui en résultent; système de gouvernement correspondant.
B. Recherche de la faveur du peuple pour obtenir ses suffrages et le dominer.
Définition via le CNRTLDans le A, la démagogie est typiquement une prise de pouvoir par un groupe restreint. C’est le contraire de « suivre la volonté du peuple » et ça correspond bien plus à la capacité d’une personne ou d’un groupe à se faire élire pour exercer le pouvoir à son profit.
Dans le B il y a effectivement une recherche de popularité et donc d’accéder aux volonté du peuple mais elle est de façade ou temporaire pour y appliquer ensuite une domination.
Dans aucun des cas le fait de laisser le peuple décider n’est de la démagogie. Ça c’est de la démocratie.
Par contre, se faire élire par des promesses pour ensuite exercer le pouvoir à son profit, ça c’est bien la définition en B, quand bien même ça sera via une élection à la base.