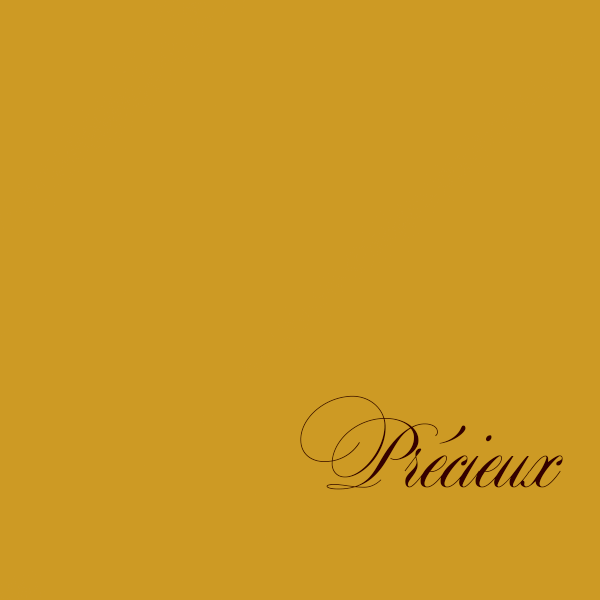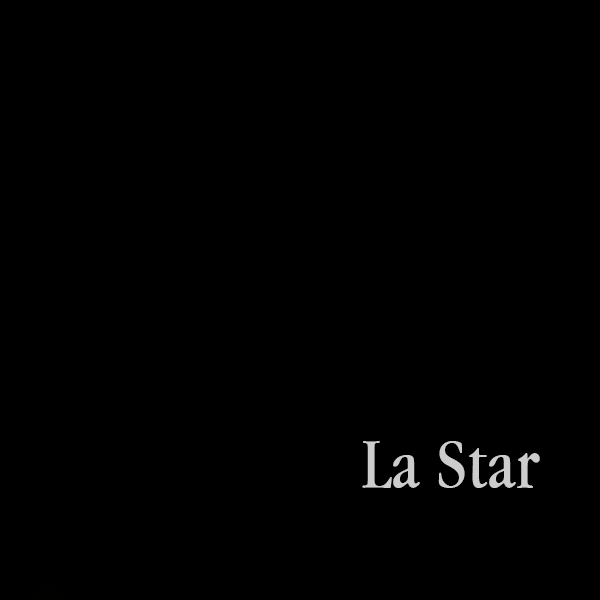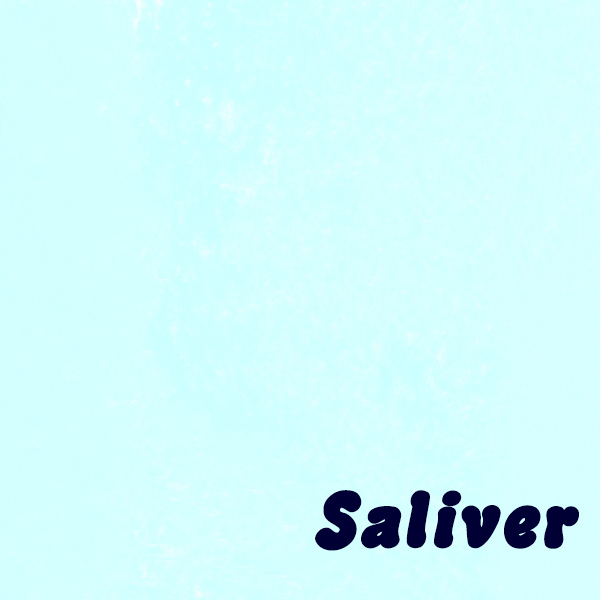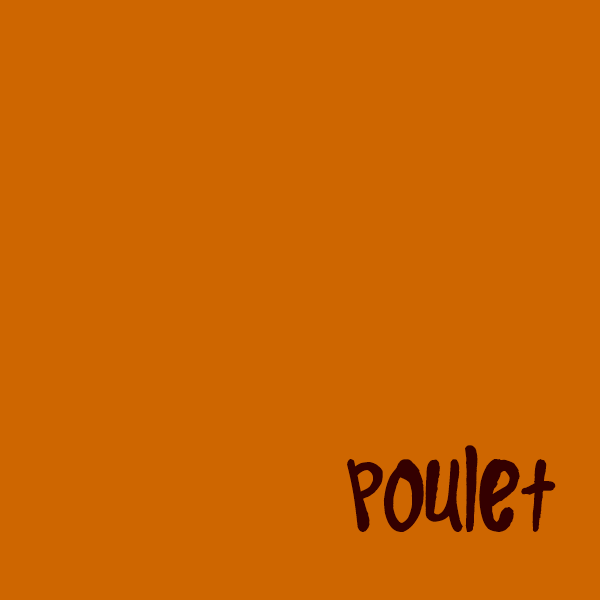J’avais fait plusieurs billets sur mes études de coûts et comparaisons entre travailleur indépendant et salarié. Je suis en train de boucler ma première année donc il était temps de faire un petit retour sur les chiffres.
Je ne prétends bien entendu aucune universalité. J’ai fait des choix que certains considéreront luxueux, non pertinents, ou qui simplement ne s’adapteront pas à toutes les expériences.
Dans tous les cas, c’est aménagé pour ma structure (SASU). Les auto-entrepreneurs auront des choix et calculs probablement très différents vu qu’ils payent des cotisations sociales sur leurs frais et ne se font pas forcément rembourser la TVA.
Première année
Temps facturé
J’ai commencé avec un client à ~3 jours facturés par semaine. Au final la prestation a duré, au point qu’on a envisagé un CDI interne et le dernier trimestre s’est fait à plein temps (bon, c’est un peu plus complexe que ça mais je vous passe les détails.
Au total je n’ai pas vraiment eu de trou non facturé faute de client, même si j’aurais parfois aimé dépasser le temps partiel prévu les premiers mois. Je n’ai pas eu non plus à courir après différents clients pour me faire payer ou établir les contrats. J’ai d’ailleurs toujours été payé sous 1 à 3 mois sans menaces (mais parfois avec plusieurs relances, considérant que le délai contractuel était de 1 mois). Ce temps gagné je l’ai principalement passé en temps de travail non facturé en faveur de mon gros client.
Sur environ 11 mois j’ai facturé entre 155 et 160 jours. J’ai explicitement indiqué une dizaine de jours travaillés non facturés sous forme de remise commerciale mais ça reste bien en deça de la réalité. Mettons que j’ai du passer facilement 30 jours de plus hors facturation (pour faire arriver les projets, parce que je ne me vois pas jouer les absents quand il y a un besoin, etc.)
Un seul client c’est assez peu de temps commercial mais il faut en compter quand même. J’ai du passer quelques jours pour initier et négocier la prestation, puis rediscuter tarifs ou suite tout au long de l’année. J’étais avec une visibilité assez réduite sur l’engagement des mois suivants donc j’ai aussi fait un peu de prospection parfois (mais vraiment le minimum). Avec plus de clients ça doit être un vrai poste mensuel.
De la même manière, je n’ai pas eu de journée blanche à attendre un client ou qui se révèle impossible à facturer pour plein de mauvaises raisons. Je ne les ai pas compté vu que j’étais en temps partiel et donc que c’est passé presque sans que ça ne se voit mais j’ai quand même eu des journées « impossible de travailler vu mon état de santé ». À ne pas oublier.
Là dessus il faut ajouter le temps administratif. Très difficile de faire moins d’une demie-journée par mois, rien qu’à établir les factures, faire le suivi, collecter et numériser tous les justificatifs, et tout saisir en ligne. J’imagine que j’aurai encore un bon jour au moment de la clôture et j’ai déjà passé quelques jours pour me documenter sur les questions fiscales. Je ne sais pas si je dois le dire mais j’ai passé aussi un temps significatif à chercher et passer commande pour mon mobilier et tout ce que j’ai acheté. Ça parait « en plus » mais c’est quand même quelque part du temps que j’ai passé sur la société. Au final je ne serai pas étonné d’avoir passé 15 jours sur de l’administratif et « temps lié à mon activité professionnelle » (estimation au gros doigt mouillé).
Temps effectif travaillé et facturé
|
155 jours
|
Temps effectif travaillé mais non facturé (volontairement)
|
30 jours
|
| Temps commercial et prospection |
6 jours
|
Temps perdu non facturé / journée blanche
|
–
|
| Temps maladie / incapacité |
6 jours
|
Temps administratif et temps annexe à la société
|
15 jours
|
Temps libre / congés hors week-end et jours fériés
|
40 jours
|
Au final une semaine de congés de plus qu’un cadre syntec avec ses 5 semaines de congés et ses 10 jours de RTT, alors que sur le papier j’ai travaillé l’essentiel de l’année à temps partiel. Attention toutefois, je n’ai décompté sérieusement que les jours facturés, le reste est vraiment de l’estimatif avec une marge d’erreur gigantesque.
Les revenus
La prestation a commencé à un tarif correct pour du long terme même si en dessous de ma cible, parce que c’était le premier à me faire confiance mais aussi au regard de l’activité (open source, utilité sociale, intérêt personnel, etc.). Ce tarif a baissé de 25% quand on est passé à plein temps et qu’on a acté l’issue sous forme de CDI (en gros pour correspondre au coût entreprise du CDI qui suivrait).
Je ne sais pas encore comment je vais sortir ces revenus. Probablement une partie en salaire sur les derniers mois de l’année civile (avec environ les mêmes cotisations que pour un salarié classique, donc quelque chose comme 55% de net avant impôts sur le revenu) et une partie en dividendes (il faut payer 0, 14 ou 28% d’impôts sur les sociétés suivant le palier, puis la flat tax à 30% qui couvre à la fois les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu). Oui, les auto-entrepreneurs doivent rigoler à me voir avec ce niveau de fiscalité mais il y avait de bonnes raisons pour cela.
D’ailleurs, note fiscale : Il y a potentiellement une formule intéressante pour ceux qui ont créé leur SAS en 2018 et qui projettent d’être salarié par une autre structure en 2019. Avec l’arrivée du prélèvement à la source, l’impôt sur le revenu lié aux salaires de 2018 sera remboursé si vos montants traitements et salaire 2019 sont égaux ou supérieurs à ceux de 2018. C’est le cas pour tout le monde, mais dans votre cas ça veut dire qu’exceptionnellement l’option « salaire » est plus avantageuse fiscalement que l’option « dividendes » (et qu’en plus ça vous ouvre des droits retraite et maladie, ce que les dividendes en feront pas).
Investissements, frais et taxes
Environ 8 000 € hors TVA (elle est remboursée pour les SAS) de frais fixes, dont environ 25% refacturés. Pour obtenir le net, il faut bien évidemment retirer aussi l’éventuel impôt sur les sociétés, les cotisations sociales, et l’impôt sur le revenu si vous allez jusque là.
Transport et restauration : J’habite à Lyon, je me déplace sur Paris. Transport et restauration sont logiquement le plus grand poste, avec respectivement 2 100 et 350 €. L’essentiel est refacturé au client donc je ne sais cependant pas si ça compte vraiment.
Parce que je n’avais pas envie de compter à l’euro près et justifier chaque sandwich ou restaurant, et parce que je voulais une façon de ventiler les coûts de l’abonnement SNCF qui était bénéfique pour tout le monde, j’ai choisi de refacturer ces frais au forfait en fonction de mon premier déplacement. Au total j’ai refacturé dans les 1 900 €, laissant 550 € à ma charge. Pas très bon calcul pour moi, tant mieux pour mon client.
Conseil : Les abonnements fréquence SNCF sont très vite rentables. Le 50% se rembourse à moins d’une dizaine d’aller-retour dans l’année, même en considérant que vous auriez parfois quand même eu des réductions ponctuelles. Pour le même prix ça vous donne une flexibilité totale avec la possibilité de prendre vos billets en dernière minute et les annuler ou reporter sans frais. J’en vois encore qui ne prennent pas la carte, à mon avis vous faites erreur.
Mobilier et matériel : Les deux gros postes choisis sont tout ce qui est lié à l’équipement du bureau et l’équipement informatique/électronique. Au total j’ai 1 100 € pour le bureau et le mobilier, 400 € pour l’électronique, hors taxes.
C’est beaucoup, d’autant que je n’ai pas eu à renouveler mon poste informatique ou mes écrans, qui allaient très bien. J’ai fait le choix d’investir dans une chaise ergonomique, un bureau assis/debout électrique, un bon ventilateur sur pied silencieux, un casque bluetooth, et j’ai eu à renouveler mon téléphone portable. J’ai pris du haut de gamme sur beaucoup de choses, parce que c’est mon environnement de travail, mais rien n’oblige à investir autant.
Comptable, assurance, banque : Viennent ensuite les postes presque obligatoires que sont le comptable (entre 1 600 et 1 800 € hors taxes annuels), la mutuelle (1 100 € pour toute la famille, considérant que ça ne représente que trois trimestres, j’étais couvert autrement pendant une part de l’année), le compte bancaire avec les frais associés (200 €) et les frais de création de la société (310 €).
Logiciels, services, consommables : Le reste ce sont les logiciels, frais serveurs et autres abonnements (250 €) et un chouia de papeterie (25 €).
Je n’ai pas de frais de loyer. Je me vois mal en coworking sachant que je suis en visio plus de la moitié du temps (sauf à louer un bureau dédié mais je ne vois alors pas trop l’intérêt). Pour ceux qui veulent optimiser et qui travaillent de chez eux, il doit y avoir moyen de louer leur pièce à leur société. Je ne suis pas allé jusque là.
Transport (y compris refacturés)
|
2 100 €
|
Repas (y compris refacturés)
|
350 €
|
Mobilier et équipement bureau
|
1 100 €
|
Matériel électronique
|
400 €
|
Poste informatique (existant)
|
0 €
|
Comptable
|
1 700 €
|
Mutuelle (3 trimestres)
|
1 100 €
|
Banque, compte et frais
|
200 €
|
Création société
|
300 €
|
Logiciels, serveurs et abonnements
|
250 €
|
Papeterie et consommables
|
25 €
|
Loyer et charges bureau (non facturés)
|
0 €
|
Taxes (estimation CFE)
|
500 €
|
Projection sur une année standard
Là j’ai eu une première année avec des frais partiels, j’ai investi sur certains postes et en ai eu d’autres vides exceptionnellement. Difficile d’en tirer des conclusions sur un rythme de croisière. Du coup voici une tentative sur un éventuel budget prévisionnel annuel (montants hors TVA, j’ai sorti les frais de déplacement potentiellement refacturés) :
Repas non refacturés
|
800 €
|
Transport non refacturés
|
1 000 €
|
Conférences
|
2 000 €
|
Formation
|
2 000 €
|
Comptable
|
2 000 €
|
Banque
|
250 €
|
Mutuelle
|
1 500 €
|
| Assurance |
500 €
|
Logiciels et abonnements
|
500 €
|
Mobilier et équipement bureau
|
350 €
|
Équipement électronique et telecom
|
350 €
|
Équipement informatique
|
1 000 €
|
Consommables, papèterie et publicité
|
200 €
|
Loyer et charges bureau
|
0 €
|
Taxes (estimation CFE)
|
500 €
|
Oui, j’ai tendance à prévoir des budgets surévalués et à prendre parfois des options haut de gamme mais on est dans les 13 000 € hors TVA sachant que les lignes d’équipement sont des montant déjà amortis, donc une moyenne lissée par année. Rapportés aux jours facturés on est déjà entre 75 et 100 € par jour facturé.
Transports non refacturés : 1 000 € de transports non refacturés c’est une moitié de carte fréquence annuelle Lyon-Paris, quelques trajets pour prospection et d’autres qui sont à ma charge parce que j’aurai choisi d’être en vacance plus loin que prévu (et sans la réduction de l’abonnement fréquence).
Repas non refacturés : Là j’ai eu un client toute l’année. Clairement j’ai retenu une chose c’est que le temps commercial était important. Si on veut se faire un réseau, le maintenir, il faut rencontrer au moins une personne par semaine. 1 000 € de repas c’est un déjeuner ou diner par semaine travaillée, parfois juste un café mais parfois il faudra payer pour les deux.
Conférences et formations : Je n’ai pas eu à payer conférences et formations cette année. Si je compte trois conférences avec transport et hébergement et une formation experte dans les mêmes conditions, on chiffre très vite à 1 500 ou 2 000 € pour les deux postes. Après il suffit que je décide de ne pas faire de formation ou d’être invité en conférence pour que d’un coup ça passe à zéro mais je préfère prévoir le budget pour ne pas y renoncer.
Administratif (comptable, banque, assurances) : On est globalement sur les mêmes frais que cette année modulo les augmentations, les frais annexes et les pertes de réductions dues à la première année. J’ai aussi ajouté les 500 € d’assurance pour la responsabilité civile professionnelle. Faire le récapitulatif de fin d’année vient de me rappeler que je n’ai toujours pas donné suite aux devis et que je ne suis pas couvert (même si l’assurance n’est pas obligatoire, prenez-la).
Abonnements et logiciels : J’ai grossi les logiciels et abonnements parce que j’ai fini par les faire porter par la société tard dans l’année et que je n’ai pas encore tout ce qui est dans ma cible. Rien qu’une sauvegarde en ligne, un serveur en ligne, un peu de stockage sur le cloud, plus quelques licences, noms de domaine et tout ce qui va avec, on chiffre vite. Bon, c’est peut-être un peu sur-estimé mais vu les autres montants je n’ai pas envie de calculer à 50 € près.
Mobilier et équipement de bureau : Le mobilier j’ai 1 100 € cette année. J’imagine qu’il peut rester une lampe, une étagère ou bibliothèque, des stores à changer ou je ne sais quoi du style. Mettons 1500 € sur le total. Tout ça est censé durer 10 ans mais je ne me vois pas prévoir sur une telle durée alors j’amortis sur 5 ans. C’est énorme parce que j’ai fait des choix de haut de gamme cette année mais je pense être plutôt sous-estimé en ne me laissant que 400 € cumulé sur les quatre années suivantes.
Équipement électronique et télécom : J’entends là tout ce qui est accessoire à mon poste de travail. C’est un smartphone personnel mais aussi potentiellement du matériel de test à acheter d’occasion (ipad, iphone, android, windows…), un casque audio, une webcam grand angle, etc. J’espère faire durer tout bien plus longtemps mais je donne un amortissement sur 3 ans à l’électronique vu que ça tomber en panne, être cassé, être perdu, être volé, etc bien avant la fin de vie « normale ». Là aussi on peut être plus frugal mais je ne crois pas que je sur-évalue tant que ça mon futur. Disons que je doute que ça tombe sous les 200 € de toutes façons.
Équipement informatique : Reste l’équipement informatique principal. Je compte un poste portable mac haut de gamme avec l’apple care, deux écrans haut de gamme, les accessoires, probablement un système de disque local. Le set-up complet fait probablement 4 000 € hors taxes (et heureusement que je n’ai pas à tout acheter d’un coup en début d’activité). Pour les mêmes raisons que plus haut je compte un amortissement sur 4 ans même si une partie du matériel devrait bien évidemment durer plus longtemps. Pour peu que je force un renouvellement à 4 ans pour des questions de confort, de performance ou simplement de faiblesse face aux sirènes du marketing et des nouvelles technologies, ça peut même finir à plus de 1 000 € annuels.
Consommables, papeterie, publicité : Je n’ai quasiment rien à mon budget cette année, mais essentiellement parce qu’on a confondu la maison et la société, et tout payé côté perso. Je consomme déjà un cahier par mois, que je prends de bonne qualité parce que sinon ça ne me donne pas envie d’écrire dedans. Mettons un jeu de cartouches jet d’encre par an, du papier, quelques stylos, des cartes de visite de très bonne qualité, peut-être quelques impressions plaquette ou stickers. 200 € c’est très arbitraire, mais ça ne sera pas 20 € tous les ans.
Loyer : Le télétravail me pèse. Je préfère nettement un bureau avec des gens mais les openspace de coworking me sont inaccessibles considérant que je passe la moitié de ma journée à parler en visio et que je ne me vois pas payer une salle dédiée pour finalement rester seul comme si j’étais chez moi. Peut-être que je me louerai ma pièce de bureau à ma société mais ça a juste un impact fiscalité, je ne le compte pas en vrai frais ici.
Pour autant, attention à bien le compter quand vous détaillez vos frais à quelqu’un qui discute vos tarifs ou quand vous réfléchissez à créer votre structure : Ça vous occupe bien une pièce que vous ne pouvez plus vraiment dédier à un autre usage, même l’utiliser en chambre d’ami pour héberger quelqu’un ponctuellement est compliqué. Vous payez ou avez payé une pièce rien que pour ça et vous aurez à le faire à nouveau si vous cherchez à déménager. Ce n’est pas magiquement gratuit (enfin sauf si vous travaillez depuis votre lit ou depuis le canapé du salon, mais je ne le conseille pas).
Et vous ?
J’imagine que ma projection de 13 000 € de frais est dans le haut du panier et que certains auto-entrepreneurs doivent être sous les 2 000 €, mais je suis curieux de voir quelles sont les grosses différences et si vous avez des postes que j’ai oublié.
Pareil sur les temps travaillé. Je m’attendais à pouvoir facturer plus mais je me rends compte que même à plein temps, c’est franchement difficile de facturer plus de 180 jours. Pour ceux qui font des missions courtes, j’imagine que plus 120/140 doit assez rapidement devenir difficile.
Vous m’en dites un peu plus ici ? Quitte à faire vous-même un long billet chez vous ensuite.