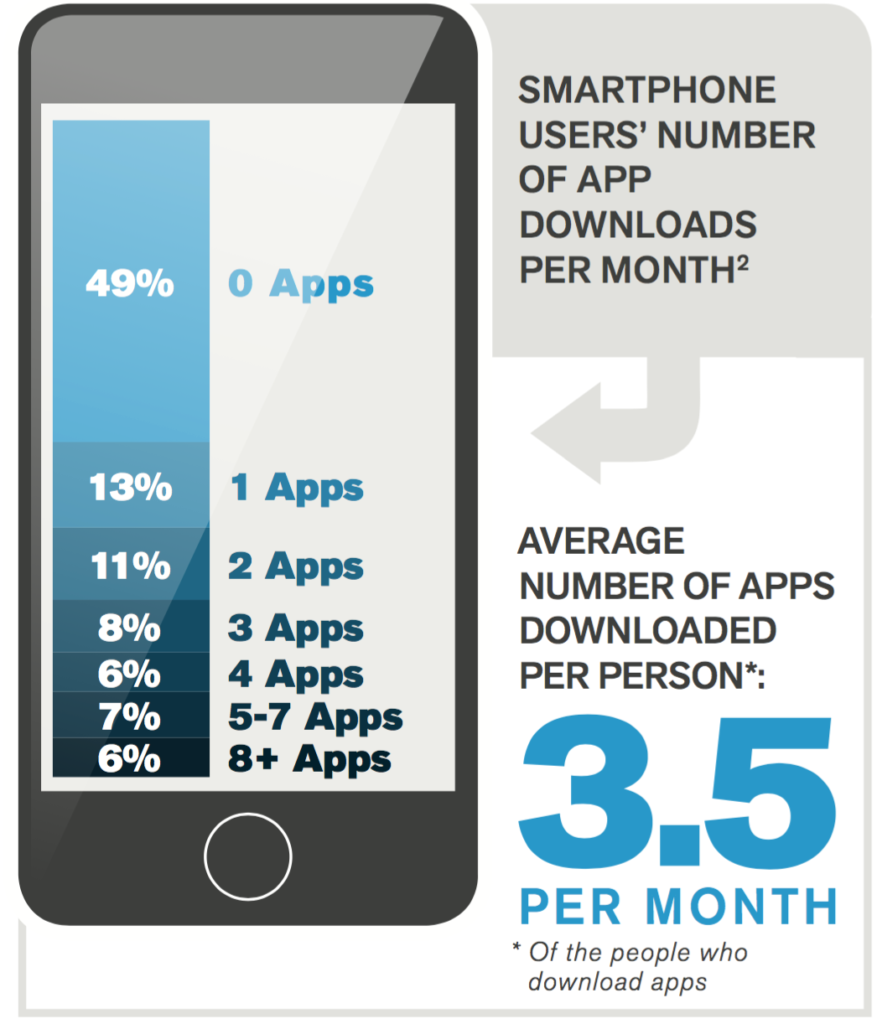Plusieurs même. Pour celui ou ceux qui arrivent à me trouver un groupe qui convient à mes crédos pour militer politique avec eux.
Difficile de se définir avec quelques phrases, et mes écrits passés sont probablement plus représentatif de mes opinions mais :
J’ai un penchant social très marqué. Je souhaite que la collectivité permette à chacun de vivre décemment : santé, transport, logement, éducation, mais aussi confort élémentaire. Cela n’a pas a être soumis à mérite ou condition.
Plus généralement je crois à la mise en commun de tous les services publics et de tout ce qui est dans l’intérêt collectif. Pour un exemple ça sous-entend des remboursements à 100% pour le système de santé, l’université en accès libre et gratuit, ou des transports en commun locaux gratuits.
Je crois à un État au service et sous contrôle des citoyens, qui leur est assujetti. J’attends donc une transparence de l’État et des collectivités à tous les niveaux et dans les moindres détails, avec des règles qui limitent et contraignent ceux qui ont le pouvoir. Aujourd’hui nous tendons vers le contraire, le contrôle du citoyen par l’État, et c’est d’un grand danger.
Je cherche un rapport au travail différent, l’arrêt de la domesticité et de l’exploitation d’une partie de la population au profit d’une minorité, l’arrêt la culpabilisation et la précarisation comme modèle de gestion du non-emploi. Il ne faut pas qu’adapter, il faut trouver un autre modèle. Le revenu d’existence est une piste mais je suis prêt à en discuter d’autres.
Je mets définitivement la vie des citoyen·nes en priorité par rapport à la question financière, commerciale, économique. Je ne crois pas à l’axiome qui veut que le premier item découle forcément des trois suivants.
Je crois aux institutions publiques, à la fonction publique, au services publics, et à la fiscalité pour financer tout cela. Il est toujours préférable de payer le moins possible, mais étrangler nos hôpitaux ou nos écoles ne sera jamais un bon investissement. Réduire le collectif permet de dégager de la marge de manœuvre aux plus aisés en assujettissant les plus faibles. Je m’y refuse.
Je crois que la finalité des collectivités publiques est d’assurer une bonne vie aux citoyen·nes. L’économie n’est qu’un moyen, pas une finalité. On se trompe souvent de priorités en privilégiant l’économie et en partant de l’axiome que le reste en découle forcément.
Je crois que tout le monde doit avoir accès à des soins complets, un toit, et globalement de quoi vivre correctement.
Je crois aux libertés civiles, aux droits de l’H, à la démocratie, à l’État de droit, à l’indépendance de la justice, à l’importance des institutions.
Je crois à l’Europe. Je ne crois pas aux frontières, au nationalisme qui se déguise en patriotisme.
Je crois à la démilitarisation.
Je ne crois pas à la pertinence du nucléaire actuel, ni sur les risques ni sur l’aspect économique, et je crois qu’il faut en sortir mais pas en précipitation. Je crois (cette opinion a évolué), malgré tout ce que je peux lui reprocher, que le nucléaire reste notre meilleure — ou notre moins pire, c’est selon — option dans l’urgence climatique qui est la nôtre. Indépendamment, je crois à l’importance de continuer la recherche et les expérimentations. J’ai pas la solution et ne crois pas que dire « il faut du renouvelable » soit si évident, mais je crois qu’on doit continuer à essayer d’imaginer des choses.
Je crois à la diversité, au respect des autres, de tous genre, opinion, culture, couleur de peau, choix de vie, etc. Je crois à la laïcité qui impose à l’État de ne pas se préoccuper des religions mais de respecter la liberté de pratique de chacun, y compris dans l’espace public. Je rejette les velléités d’imposer un ordre moral venu du siècle dernier, des uniformes ou tout ce qui a trait à un fantasme du « c’était mieux avant, la jeune génération est décadente ».
Je suis certain que j’en oublie plein, je complèterai peut-être au fur et à mesure. Voyez-vous quel groupe puis-je rejoindre ?