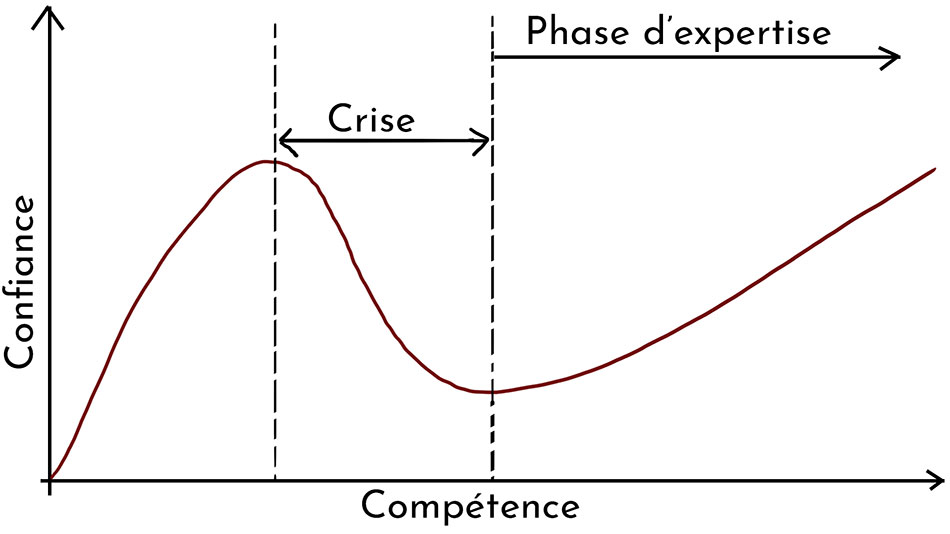Je lis des docs qui parlent de renouvellement de matériel pour la 5G et j’ai l’impression de retrouver les analyses fumeuses des cabinets de stratégie qui se sont toujours plantés dans mon corps de métier.
Ils sont tous d’accord sur trois points :
- En France, aujourd’hui le renouvellement des téléphones se fait tous les 22 à 24 mois en moyenne (et j’avoue que j’aurais plutôt parié sur 36 mois pour ma part).
- Le marché des téléphones tend à croitre de moins en moins vite, voire à décroître.
- On commence à toucher 70 à 85% de la population âgée de 12 ans et plus (on ne se limite même pas aux adultes là).
Alors jouons à un jeu.
Mettons que la 5G s’activera partout au premier semestre ou second semestre 2021, ce qui est une hypothèse très favorable à la théorie d’une augmentation du renouvellement.
Mettons que ceux qui sont de nature à renouveler leur matériel pour profiter de la 5G ne sont pas plus technophiles que la moyenne et renouvellent tous les 22 mois en moyenne. Ici aussi l’hypothèse est favorable au point de ne pas en être crédible.
Enfin, on trouve des téléphones compatibles 5G dès avril 2020. Une seconde vague arrive en juillet. Pour simplifier je considère leur disponibilité en juillet, même si c’est là aussi assez favorable. Tout n’est pas compatible 5G à cette date, mais celui qui veut un compatible 5G le trouvera.
| 5G dispo entre janvier et juin 2021 | 5G dispo entre juillet et décembre 2021 | |
| Aurait naturellement renouvelé entre juillet et décembre 2020 | ✅ | ✅ |
| Aurait naturellement renouvelé entre janvier et juin 2021 | ✅ | ✅ |
| Aurait naturellement renouvelé entre juillet et décembre 2021 | ⚠️ | ✅ |
| Aurait naturellement renouvelé entre janvier et avril 2022 | ⚠️ | ⚠️ |
On voit que même en se limitant à ceux qui vont effectivement changer leur téléphone uniquement pour accéder à la compatibilité 5G (ce qui ne concerne évidemment pas tout le monde) et même avec des hypothèses démesurément favorable, ça va ne va concerner que trois cases dans mon tableau.
Petit calcul : Si tous les utilisateurs sont répartis équitablement, les utilisateurs qui auront la 5G dès le premier semestre 2021 mais qui auraient renouvelé au naturellement au second semestre représentent environ 14% de la population cible, et ils avanceront leur renouvellement de 27%.
Les deux dernières cases représentent chacune 9% de la population. Celle de la première colonne avancera son renouvellement de 50%. Celle de la seconde colonne avancera son renouvellement de 23%.
0.14 × 0.27 + 0.09 x (0.5 + 0.23) = 10%
On obtient donc une augmentation de 10% de la production de smartphones sur une période de 22 mois pour la population qui serait de nature à changer de téléphone uniquement pour avoir la 5G.
Pas rien, mais pas la fin du monde non plus, même avec des hypothèses démesurément favorables à la théorie du renouvellement anticipé.
Maintenant cherchons des hypothèses un peu plus réalistes.
Ceux qui sont de nature à changer leur smartphone uniquement pour avoir la 5G sont probablement en bonne partie des technophiles. Il est donc logique de penser qu’ils ont un renouvellement plus fréquent que la moyenne (mamie change peu son téléphone, et ne va certainement pas changer son téléphone pour la 5G). Mettons qu’ils renouvellent en moyenne 20% plus vite (estimation au doigt mouillé) ça nous donne 18 mois plutôt que 22.
On peut aussi penser qu’une partie de la population, surtout hors zone urbaine, ne sera pas couverte avec une 5G en haut débit dès 2021. Les plans de déploiement sont plus long que ça. Ajoutons donc une colonne pour faire dériver au premier semestre 2022. Là aussi, c’est raisonnable, je peux parier que les déploiements ne seront pas finis à cette date.
| 5G jan. à juin 2021 | 5G juil. à déc. 2021 | 5G jan à juin 2021 | |
| Aurait naturellement renouvelé entre juillet et décembre 2020 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aurait naturellement renouvelé entre janvier et juin 2021 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aurait naturellement renouvelé entre juillet et décembre 2021 | ⚠️ | ✅ | ✅ |
Ça fait moins peur d’un coup, hein ?
Notre 10% de tout à l’heure arrive dans les 4%. Ajoutons que tout le monde n’est pas de nature à changer son téléphone pour de la 5G, on arrive dans les 2 à 3%.
Avec des hypothèses plus réalistes, la 5G pourrait entrainer une augmentation de consommation de smartphone de l’ordre d’au mieux 2 à 3% pendant 18 mois, puis plus rien ensuite (le parc étant alors à son renouvellement normal).
Ce ne sont pas des estimations, ce sont des ordres de grandeur pour donner une idée.
Vous n’y croyez pas ? Pourtant les projections de croissance des constructeurs de smartphone correspondent à ces résultats. L’histoire de la 4G aussi.
En même temps avec une fréquence de renouvellement déjà très élevée et un marché occupé dans les 80%, imaginer un bonus de croissance gigantesque est juste mathématiquement impossible. Ce n’est pas pour rien que la croissance du marché s’est arrêtée.
Pour y arriver il faudrait convaincre d’un coup tous ceux qui habituellement ne renouvellent pas ou peu leur smartphone. Problème, ce sont justement les moins technophiles, ceux qui ne se laisseront pas facilement convaincre de faire un renouvellement inutile sous prétexte de 5G. Il faudrait leur couper 3G et 4G pour les forcer, mais ça n’arrivera pas.
Ok, mais alors comment des études arrivent à parler d’effet majeur ? Il suffit de les lire.
Celles que j’ai croisé regardent les projections de vente de téléphones en 5G (qui vont effectivement croissantes) et le fait que c’est un argument de vente et de marketing de la part des opérateurs ou des constructeurs, et en tirent que ça va augmenter les ventes. Là vu qu’on parle d’augmentation on tire au doigt mouillé un scénario bas, un scénario moyen et un scénario haut. Rien de plus.
Les plus délirantes vont compter une explosion de la réalité virtuelle et de casques VR dans l’équation, parce que tel ou tel forum a fait il y a quelques années une projection sur ce que serait l’avenir 10 ou 20 ans après. Il suffit de regarder celles d’il y a 10 ans pour voir ce que ça vaut (et même si c’était vrai, imputer la VR à la 5G c’est assez osé).
Bien évidemment tout ceci est partiel. Il y aura aussi des usages que nous n’aurions pas eu sans 5G, et probablement du matériel pour ça. Il y aura bien une augmentation. Elle est juste totalement impossible à prévoir.
Dire « il y aura effet rebond » n’est pour l’instant basé sur rien de tangible, même pas l’histoire.
C’est d’autant moins vrai que ces nouveaux usages, cette nouvelle bande passante voire ces nouveaux matériels vont aussi permettre des choses différentes.
On a par exemple moins de consommation sur les antennes. On peut imaginer (à long terme) plus de visio, de télésurveillance et de télérelevés et donc moins de déplacement. On peut aussi imaginer la 5G dans les transports, donc plus d’automatisation et moins de consommation d’énergie.
On peut imaginer plein de choses. C’est un peu plus étayé par l’histoire et les besoins d’aujourd’hui que les hypothèses d’effet rebond, mais ce n’est pas plus chiffrable. Je vais donc m’en abstenir.
Peut-être que le solde CO2 de la 5G sera mauvais, mais ça reste encore franchement difficile à autrement qu’en boule de cristal. Possible aussi qu’il se révèle très bon. Ce qui est probable, par contre, c’est que le renouvellement des smartphones ne jouera qu’un effet très mineur dans tout ça.
Je vous remercie d’éviter tous les délires sur « dans ce cas on ne fait rien ? », « pffff, encore un qui croit au solutionisme technologique » ou au contraire « pfff ces écologistes rétrogrades ». Si vous voulez faire de l’idéologie binaire, faites-le sans moi.
Je vais quand même ajouter :
Vous voulez faire quelque chose ?
- Imposez une garantie matérielle sur 3 ans
- Imposez un suivi logiciel actif sur 5 ans
- Interdisez le verrouillage d’Apple qui empêche les réparateurs tiers ou les pièces compatibles
- Imposez un remplacement de la batterie aisé et les spécifications nécessaires
- Arrêtez d’obliger à fournir des oreillettes par défaut
- Interdisez de fournir le chargeur avec le smartphone
- Imposez l’utilisation d’un mécanisme de charge rapide standardisé plutôt que l’usage de blocs de charge propriétaires
Il y a bien plus à proposer mais rien que ça aura bien plus d’effet que dire oui ou non à la 5G.