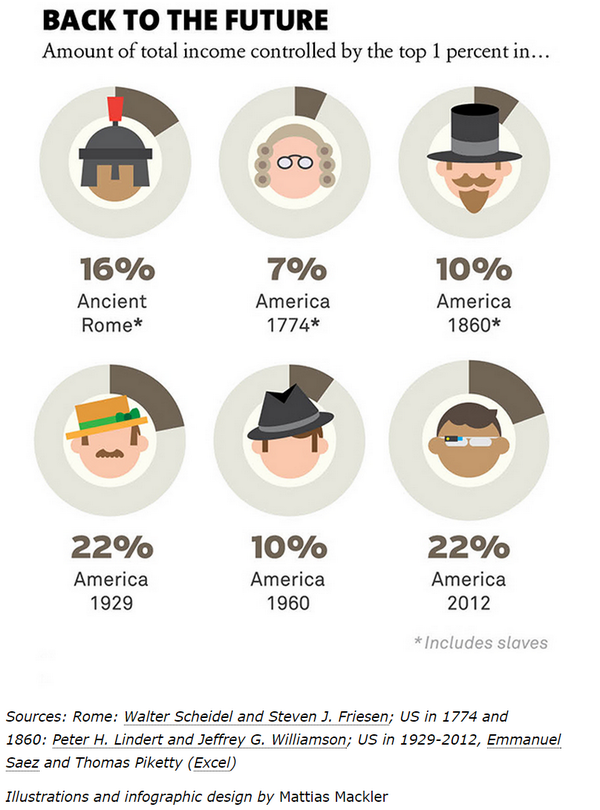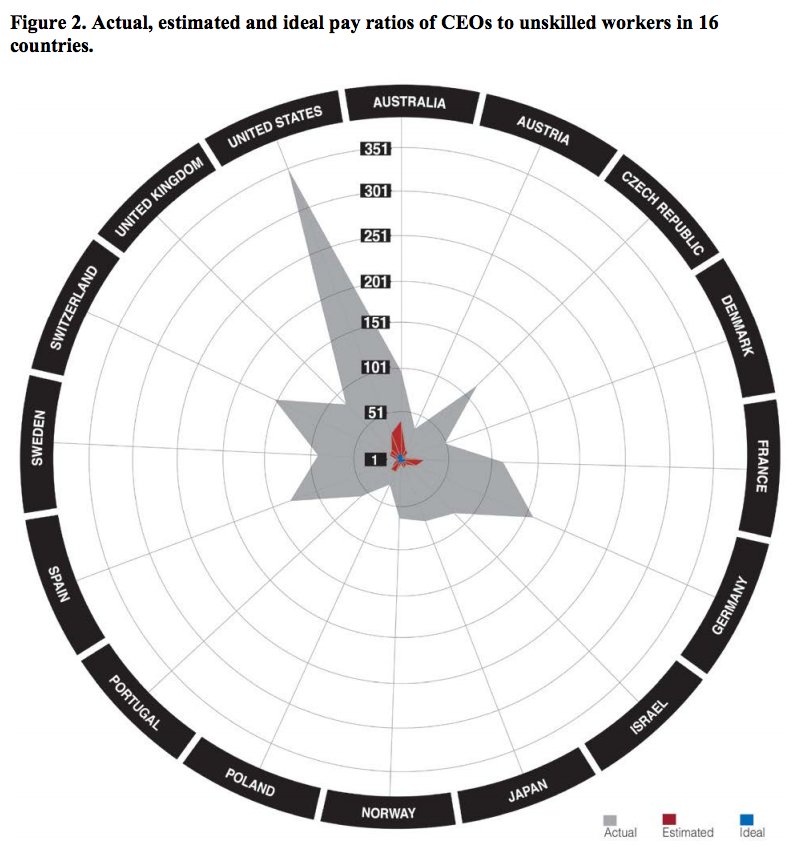Je sais comment nous en sommes arrivés là, mais je me résous à ne plus me considérer en démocratie.
Le mot est fort, mais à force de peur d’inefficacité et peur des extrêmes, nous avons abandonné toute représentativité nationale.
S’il ne fallait qu’un seul symptôme : Une sensibilité qui regroupe près de 20% de la population n’a qu’à peine plus de 0,3% de la représentation à l’Assemblée.
On dit que la démocratie peut être la dictature de la majorité. Le problème c’est que ça se voit un peu quand on muselle les voix divergentes. On a trouvé pour ça un système magique : On fonctionne par représentation.
Prenez 10 personnes pour le rouge, 8 pour le bleu, 4 pour le vert, 4 pour le noir. Faites un scrutin pour élire des représentants. Il y aura une alliance, mettons rouge et vert. Résultat de l’élection : 2 rouges 1 vert. Faites désormais voter les décisions par les représentants : Les rouges décideront de tout, et les verts ne seront que rarement divergents (au risque de ne plus faire partie de l’alliance et de ne plus avoir du tout d’influence). On aura l’impression d’un consensus.
Si c’est moins binaire que ça, il suffit d’empiler les représentations. À la fin les voix divergentes n’auront quasiment plus aucun pouvoir de nuisance, le tout avec un joli verni démocratique vu qu’on aura utilisé des élections.
Majorité de majorité
À l’Assemblée nationale, on ne prend que le candidat majoritaire de chaque petite circonscription. Le système est quasiment fait pour que le parti principal rafle tout, ou qu’à la limite deux partis à force égales se battent entre eux. Les autres ne doivent leur présence qu’à des jeux d’alliance ou des anomalies géographiques.
Au Sénat c’est encore plus simple. On prend les gagnants des élections pour choisir la représentation. Une voix non majoritaire n’a quasiment aucune chance d’être visible.
Dans un cas comme dans l’autre, c’est un système qui fait fonctionner la majorité de la majorité. Autant dire que les voix minoritaires sont muselés par le principe même.
Majorité de majorité de majorité
Pour renforcer encore ce système, on y siège par groupes qui votent quasiment en bloc (le « quasiment » est même de trop au Sénat où le chef de groupe vote pour tout le monde).
Au niveau des partis, les petits doivent se soumettre ou perdre des droits ou du financement public : Ces derniers sont attachés à la constitution d’un « groupe », c’est à dire déjà vingts élus. Bien évidemment, les deux représentants du FN à l’Assemblée nationale n’ont pas de groupe. Les 20% du peuples se sont transformés en 0,3% des représentants, et ces derniers n’ont même pas autant de pouvoir ou de financement que les autres.
Au niveau des individus ce n’est pas mieux. Comme rien ne peut exister hors des partis majoritaires, chacun doit se soumettre au groupe, voter avec le groupe s’il veut pouvoir concourir aux prochaines élections. Ce n’est pas aussi binaire, mais ça revient bien à ça.
Qui décide pour le groupe ? dans le meilleur des cas la majorité. On en était à la majorité de la majorité, on passe donc à la majorité de la majorité de la majorité (ouf).
Majorité de majorité de majorité de majorité
Mais ne nous arrêtons pas là. Si le groupe a une certaine autonomie, le parti reste quand même essentiel. C’est lui qui a les financements pour les prochaines élections, lui qui décide qui portera l’étiquette (c’est à dire dans une majorité des cas, qui est éligible).
Un noyau dur décide d’à peu près tout, surtout quand le gouvernement, le président et l’Assemblée sont du même bord.
C’est ce noyau au niveau du parti qui a une énorme influence voire pression sur le groupe parlementaire, lui-même qui décide de ce que sera le vote à l’Assemblée, élue sur la base des majorités locales. Ouf, on a donc une majorité de majorité de majorité de majorité. Délire…
Qui dirige la majorité de majorité de majorité de majorité ?
On pourrait aller plus loin et voir, quand il y a un président fort, ou un premier ministre charismatique ou un leader important, que ces derniers dirigent quasiment le noyau dur du parti.
Franchement, que ce soit à ce niveau ou au précédent, on a un tout petit groupe de quelques individus qui décident de tout. Bien évidemment le groupe parlementaire peut se rebeller, les parlementaires peuvent faire sécession, et la population peut tout à fait voter en masse d’un coup pour un nouveau parti.
En théorie. Au niveau du groupe ou des parlementaires c’est un peu l’arme atomique donc ça reste généralement au niveau des menaces ou du bras de fer.
Au niveau de la population en raison des financements publics et de la peur des extrêmes ou du « vote utile », c’est difficile. Ce serait du même ordre d’importance qu’une révolution. Une révolution non violente, mais une révolution quand même, qui détruit le système pour en construire un autre.
Démocratie ? foutaises
Ce n’est pas pour rien qu’on met désormais en avant le terme de république : La structure se protège derrière ce terme en faisant croire que les démocratie et république vont ensemble.
Oh, nous n’en sommes pas à une méchante-dictature. On trouvera des exemples pour faire peur et pour dire « nous ne sommes pas comme eux ». Mais en pratique le peuple n’a plus le pouvoir au quotidien depuis longtemps. Il n’a plus que le pouvoir de se rebeller. Pas de pouvoir au peuple, pas de démocratie ; c’est aussi simple que ça.
J’ai encore espoir qu’on puisse se réveiller et faire cette révolution non violente des institutions pour recommencer du bon pied.
Je ne sous-estime tout de même pas la résistance du système à sa propre évolution. Cette révolution ne pourra pas venir de ceux qui sont déjà dans la logique actuelle, elle se fera même probablement contre eux, même quand ils sont de bonne volonté.
Photo d’entête sous licence CC BY-NC-SA par Clint McMahon