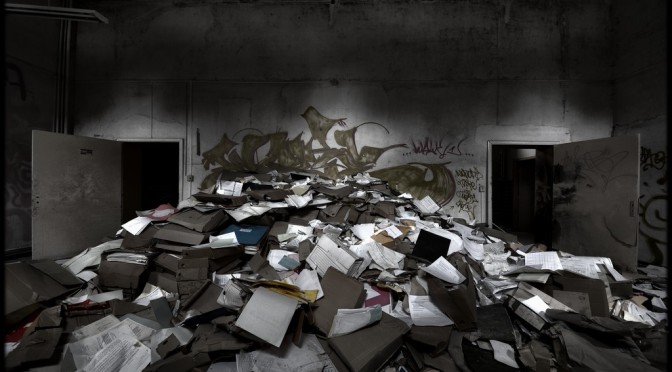J’entends encore autour de moi les gens râler sur ces enseignants trop payés, qui font toujours grève et qui sont toujours en vacances. Je rage parce que pas un n’accepterait les conditions de travail des professeurs des écoles.
Sans salaire depuis la rentrée, des enseignants reçoivent des bons alimentaires
Ce n’est que le titre de l’article de presse, mais le contenu ne vient nullement modérer le sens initial. Après deux mois sans salaire, on leur fait même l’insulte de leur donner des bons alimentaires. Et encore, c’est au professeur de s’humilier à quémander pour les obtenir.
Ils ont réussi le concours, sortent d’un diplôme BAC+5 – oui, il faut avoir un master pour enseigner désormais – souvent jeunes diplômés donc sans le sou. Vous en connaissez beaucoup qui dans ces conditions continueraient à travailler après plus de deux mois sans salaire sur un nouveau job ? Vous le feriez ?
Même quand tout fonctionne, le salaire n’est jamais versé à plein le ou les premiers mois. C’est dans le processus « normal » de l’éducation national : Le professeur reçoit un simple acompte, et le solde au mieux fin octobre.
Quant aux congés ou aux horaires soit-disant tranquilles, je vous laisse lire la petite histoire de septembre dernier – lisez-la, vraiment. Oh, et le salarié trop payé n’est en réalité payé que 2000 € bruts par mois (environ 1550 € net), pour un BAC +5 une fois le concours en poche. Quant à la sécurité de l’emploi, 13 ans d’exercice avec une bonne notation ne garantit pas une place de titulaire.
Pensez-y avant de vous moquer de la prochaine grève qui parle de mauvaises conditions de travail.