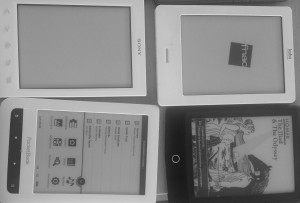Je suis très pessimiste sur les évolutions récentes dans la messagerie instantanée.
Le mieux
Pendant un temps ça s’est un peu amélioré. Les non-techniciens ne le voyaient pas mais on a commencé à ouvrir un peu les réseaux. Le protocole ouvert et standardisé XMPP s’est plus ou moins imposé comme base, et Jabber (le réseau des serveurs XMPP ouverts) commençait à prendre pas mal d’importance.
Apple iChat, Google et même MSN savaient désormais plus ou moins communiquer entre eux via ce protocole, éventuellement avec quelques artifices. Chacun pouvait aussi monter son propre sous-réseau chez lui ou dans son entreprise, avec sa propre adresse, et communiquer avec les gros réseaux de façon transparente. Même Skype avait annoncé développer un connecteur pour la partie texte de sa messagerie. AIM avait de plus commencé à s’ouvrir au réseau de Google, ce qui était un premier pas.
Mais ce n’est pas tout : AIM, ICQ, Yahoo! Facebook et bien d’autres ont migré vers ce même protocole.Même si leurs réseaux restent isolés les uns des autres, il était possible d’utiliser le même protocole et donc d’avoir des applications qui faisaient tout. C’était encore loin d’être idéal, parfois les fonctionnalités avancées des différents réseau n’étaient pas gérées, et pour certains l’implémentation était expérimentale ou en développement, mais la direction était plus qu’encourageante. Même twitter avait une interface avec le protocole XMPP pour certains flux.
Les applications Pidgin et Adium permettaient ce qui manquait encore, en implémentant tous les protocoles principaux. Sous réserve d’avoir un compte sur chaque réseau il était possible de centraliser toute la messagerie sur une seule application et de ne pas se préoccuper de savoir qui est sur quel réseau (ou même qu’il existe différents réseaux).
Il n’y a presque que Skype qui restait dans son coin mais, au moins dans nos pays, il était quasiment exclusivement utilisé pour la voix, pas pour la messagerie instantanée.
Et le moins bien
Malheureusement le « je veux mon réseau social comme Facebook » semble être à la mode et on a tout détricoté tout juste quelques mois.
Twitter ? Ils ont fermé leur interface XMPP, et les évolutions montrent qu’ils tentent de contrôler les différentes applications clientes. Le nombre maximum d’utilisateurs par application non-officielles fait qu’il est illusoir d’imaginer une compatibilité stable et pérenne avec des applications de messagerie instantanée.
MSN ? Ils ont racheté Skype et a annoncé migrer ses utilisateurs de Windows Live vers ce réseau. Le réseau MSN fonctionne encore alors que sa date d’extinction est désormais passée, mais rien ne permet de dire si ça perdurera encore longtemps.
Le protocole Skype n’est malheureusement pas ouvert et ce ne semble pas être la direction souhaitée en interne. Il est probable qu’il faille désormais communiquer avec les contacts MSN via Skype et uniquement Skype.
Il existe encore un plugin Skype pour Pidgin mais il impose d’avoir le client Skype lancé et connecté, ne couvre pas le mobile, et semble ne pas fonctionner correctement pour les utilisateurs qui ont fusionné leur compte Skype et leur compte MSN.
Google ? Google vient d’annoncer le passage à Hangout. Ils avaient déjà éteint un bref moment les échanges entre leurs serveurs de messagerie et les serveurs tiers, rompant l’interopérabilité. Désormais c’est tout le protocole XMPP qui est jeté. Impossible de communiquer avec des utilisateurs non Google une fois que vous avez migré, pas même avec les utilisateurs du réseau AIM qui avaient une liaison spécifique. Impossible aussi d’utiliser un client autre que les clients Google.
L’ancien réseau XMPP de Google est encore là mais on ne sait pas pour combien de temps. Toujours est-il que les utilisateurs vont migrer vers Hangout au fur et à mesure (consciemment ou non) et ce sont autant de gens qui deviendront injoignables pour ceux qui n’y sont pas encore. Pire : Il semble qu’ils sont encore vus comme connectés, mais ne peuvent pas lire vos messages ou vous en envoyer.
Là aussi, le protocole n’est pas connu, donc il faudra avoir un logiciel spécifique pour Hangout, impossible d’utiliser Pidgin ou un équivalent.
Sans avenir
Twitter, MSN et Google s’enferment chacun dans leur pré : impossible de communiquer avec eux depuis l’extérieur, ou d’avoir une même application qui se connecte aux différents réseaux. Difficile de compter sur Facebook pour s’ouvrir, et les autres qui étaient au stade de développement ou d’expérimentation ne risquent pas d’investir pour pérenniser la chose désormais.
Bref : Vous appartenez au réseau que vous choisissez, et vous n’êtes qu’un pion dans la guerre qui oppose les multinationales d’Internet. Le courant dominant est maintenant de fermer les frontières et de capitaliser sur les utilisateurs pieds et poings liés, c’est à dire vous. Votre propriétaire pourra vous imposer les contenus, les services ou la publicité qu’il souhaite (rassurez-vous, il attendra un peu que ça se calme avant de le faire, histoire de ne pas risquer une migration en masse). Une société souhaite lancer des contenus ou innover ? OK si elle paye votre propriétaire et n’entre pas en concurrence avec lui. Moins vous pourrez communiquer avec l’extérieur, mieux ce sera car vous serez sous contrôle de votre propriétaire de réseau.
Sauf renversement de situation ou prise de conscience exceptionnelle des utilisateurs :
- Jabber est mort à court ou moyen terme, sauf pour quelques geeks et internautes convaincus
- Vous ne pourrez plus choisir vos applications, il faudra accepter les applications officielles, en leur donnant les droits qu’elles demandent, en acceptant publicités, mises en avant ou marketing qu’elles choisissent
- Si vous n’acceptez pas de vous laisser enfermer et menotter sur un seul réseau, il faudra installer et lancer simultanément plusieurs logiciels différents non interopérables
- Le web ouvert est mal barré