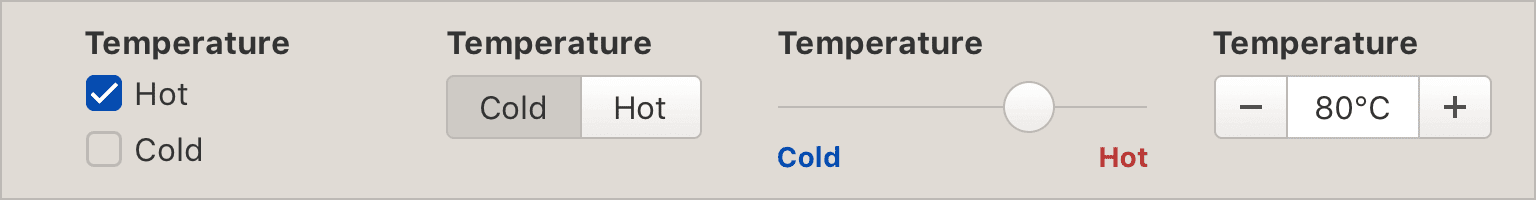Un cas d’école d’abord : en 1972, soit deux ans après le lancement officiel de la matrice de portefeuille (qui est une représentation graphique des différents domaines d’activités stratégiques de l’entreprise dans le but d’évaluer sa compétitivité et d’en déduire une stratégie), 100 multinationales américaines en avaient adopté une. Et, six ans plus tard, 75% des firmes du fameux classement Fortune 500 emboîteront le pas. Moult études ont pourtant démontré que les entreprises ayant eu recours aux matrices ont obtenu de moins bons résultats que les autres. Et il ne s’agit ici nullement d’un cas isolé : depuis un siècle environ, de multiples pratiques se sont succédées à intervalles plus ou moins réguliers pour venir orienter – de façon significative – les pratiques de gestion des firmes du monde en entier.
De ce que j’en ai vu dans mes expériences professionnelles précédentes, n’allez pas croire que les directions d’entreprises sont des puits de science et de décisions réfléchies. C’est même plutôt l’opposé : à force de prétendre être au dessus de tout et de n’avoir le temps pour rien… les décisions sont prises à partir de résumés de 5 ou 10 minutes – parfois compris de travers – plutôt que de plonger réellement dans les chiffres et les études, le tout fortement influencé par des anecdotes, des personnes proches ou des déclarations de personnes connues.