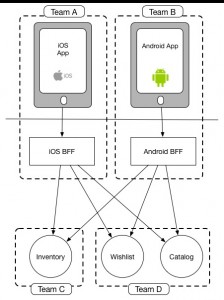The Kindle Fire comes with a SDXC card slot that outclasses every other tablet in its price range, accommodating storage cards that can hold as much as 128GB of media — but it won’t read ebooks from the slot.
Chris adds, « This seems like a strange oversight, given that every other media app on the tablet uses that card for downloading and storage, and its 5 GB usable internal memory isn’t a lot for people who have a large library of picture-heavy e-books — especially if they want to install other apps, too. »
[…]
Every walled garden wants to keep out the competition. Amazon also announced yesterday that it would stop carrying the Chromecast and Appletv, devices from Google and Apple that compete with its own Fire TV.
— via BoingBoing
Et pourtant j’ai encore des gens, à chaque fois que j’aborde des comparatifs de liseuses en expliquant avoir mis de côté les Kindle, qui m’argumentent que je réagis par intérêt ou par idéologie.
Pour l’instant le jardin est grand, doré, mais il est fermé. Demain le jardin sera peut être trop petit, ou les dorures auront disparues parce qu’il sera temps de rentabiliser. Vous, vous serez encore à l’intérieur.
Vous, nous peut-être. Je ne sais pas. Parce que l’analyse vaut pour plus que le livre numérique et Kindle.