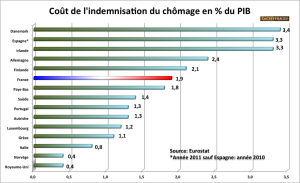 Les indemnités chômage pèsent trop sur la France, il faut réduire cet assistanat. Peut-être pas autant qu’on le croit finalement… Parfois, rien de mieux que les chiffres.
Les indemnités chômage pèsent trop sur la France, il faut réduire cet assistanat. Peut-être pas autant qu’on le croit finalement… Parfois, rien de mieux que les chiffres.
Auteur/autrice : Éric
-
Systèmes de vote
La qualité est vraiment mauvaise mais l’écoute est intéressante pour ceux qui ne maitrisent pas encore les subtilités des différents systèmes de vote et qui crient au vol de démocratie avec le système français actuel :
Je diffère toutefois de la conclusion : Le fait que plein de systèmes de vote renvoient des résultats différents n’implique pas qu’il n’existe pas de bon système de vote. Tout ça veut juste dire qu’il nous faut définir nos critères pour déterminer ce qui est juste pour nous.
Sur les cinq systèmes, les trois derniers présentés ont tendance à exclure les candidats qui ne peuvent pas faire consensus. À l’inverse, si les votes majoritaires ont tendance à éviter les consensus mous mais l’élu pourrait ne convenir qu’une faible part des électeurs.
Dans une démocratie apaisée, j’ai tendance à penser que c’est la première alternative qui a du sens (et inversement : que la seconde alternative ne peut pas mener à une démocratie apaisée).
-
7 Reasons the TSA Sucks (A Security Expert’s Perspective)
Remember those full-body scanners that leaked naked pictures of random citizens all over the Internet? The last ones were removed earlier this year, but did you ever wonder how those things were approved in the first place?
Blame Michael Chertoff, former secretary of Homeland Security and head of the Chertoff Group, which in 2010 represented a little company named Rapiscan. In addition to sounding like « Rapey-Scan, » Rapiscan was in the business of making full-body scanners. Chertoff stood in front of Congress (his friends and former co-workers) and explained that these scanners were the future of security (« and, » he neglected to add, « the future of ME getting very, very rich and horrible »). Congress listened, and for the first time they mandated a piece of equipment for use in American airports. Remember: These were politicians with no security credentials. They decided Chertoff was an honorable man and went along with everything he said.
Extrait de 7 Reasons the TSA Sucks (A Security Expert’s Perspective)
À lire aussi sur la TSA : TSA Agent Confession
-
Immunité – vote à main levée
Certains mécanismes institutionnels peuvent sembler lourds ou exagérés, mais ils sont là pour garantir nos libertés et notre démocratie en des jours plus sombres.
Malgré tout le mal que je pense de la non-levée de l’immunité de Serge Dassault, la dernière chose qu’il faudrait c’est lever le secret du vote du bureau du Sénat ou retirer globalement l’immunité des sénateurs.
Votes à bulletins secrets
L’immunité doit protéger des pressions, et là c’est ce qu’on vit. Cela m’incite encore plus à m’opposer au vote à main levée – Catherine Procaccia.
N’oublions pas que nous parlons ici de corruption et même de meurtre pour faire taire les alertes. Malgré tout nous sommes aujourd’hui dans un contexte relativement calme. Le jour où nous aurons à juger un problème de plus grand ampleur encore, où les sénateurs auront potentiellement peur pour leur vie, n’aimerions-nous pas qu’ils puissent voter à bulletins secrets ? J’irai même plus loin à demander que la répartition des votes elle-même soit confidentielle dans le bureau.
Si aujourd’hui nous instituons un vote à main levée par transparence, nous y perdons sur le long terme. Juger de nos procédures à l’aune des jours où tout est calme est de bien mauvais conseil.
La transparence de la part des élus n’est en soi pas illégitime, mais dans ce cas il faut leur permettre d’avoir de la force, et donc ici de voter en assemblée plénière (et sans votes de groupe). Il est bien plus difficile de faire taire personnellement par la menace physique 348 sénateurs qu’une poignée de gens dans un bureau.
Immunité
L’immunité part du même principe. Elle garantit la représentation du peuple contre l’arbitraire policier ou judiciaire. Aujourd’hui c’est un non-risque et nous devrions lever les immunités assez facilement sur simple demande raisonnablement justifiée – ce qui malheureusement n’a pas été fait.
Demain il est possible que ce soit la seule alternative pour éviter que des députés de l’opposition soient d’un coup mis en garde à vue opportunément avant un vote important, ou que coller des procès longs soient une manière de faire pression sur un représentant pour l’exclure ou le discréditer.
Pensez à l’Égypte et à tous ces pays qui ont fait leur révolution récemment, à ceux qui voient leurs députés emprisonnés. Ce n’est pas une question purement rhétorique, cela arrive dans d’autres pays et il s’agit d’un mécanisme pour limiter les problèmes si un jour notre pays est moins calme qu’aujourd’hui.
Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. Même si cela nous coûte aujourd’hui, donne parfois un peu d’injustice ou quelques dérapages, voire des scandales comme celui de Serge Dassault, ils ne sont que temporaires et bien moins grave que ce que nous risquons à retirer cette immunité.
Et alors ?
Tout n’est pas beau dans le meilleur des mondes. Le système fonctionne si nos représentants agissent avec honnêteté, sérieux et droiture.
Je n’oserai pas demander qu’ils laissent l’aspect partisan de côté, mais c’est toujours Catherine Procaccia qui nous montre qu’il y a problème de ce côté là :
Cela m’incite encore plus à m’opposer au vote à main levée, car on ne regardera plus le dossier mais si c’est quelqu’un de droite ou de gauche qu’on protège.
Le secret du vote est un compromis vis à vis des exigences d’un représentant du peuple de façon à le sécuriser contre les pressions insurmontables. Ici on est juste en train de dire soit que le jeu des partis est une pression insurmontable pour la démocratie – ce qui en soit est sacrément grave si c’est vrai, et mériterait qu’on les dissolve rapidement – soit que les députés préfèrent agir par intérêt politique personnel avant toute autre considération même face à des problématiques qui impliquent corruptions massives et meurtres – ce qui est finalement tout aussi grave et mériterait qu’on change immédiatement l’intégralité des députés et sénateurs.
La remarque de Catherine Procaccia est d’autant moins pertinente qu’à une ou deux exceptions près, il est presque acquis que le vote s’est bien joué dans une opposition droite – gauche quand bien même le sujet ne s’y prêtait pas du tout et malgré le secret du vote.
Donc voilà notre problème : Nos représentants ont oublié leur rôle et leur charge, et se croient dans un jeu télévisé où l’objectif est de gagner personnellement puis par équipe.
Solutions ?
Retirer leur immunité ou leur imposer une transparence des votes fera légèrement reculer certains symptômes mais ne règlera en rien le problème de fond.
Une première solution serait de refondre certains systèmes qui donnent une trop forte prime au parti gagnant, et plus globalement aux très grands partis. Plus de partis implique plus de sensibilités différentes, plus d’options pour à la fois suivre son opinion et suivre son groupe.
Mais surtout limiter les mandats devient sacrément urgent, autant dans le cumul que dans la durée. Nous avons fait un premier pas, il est essentiel d’aller encore plus loin. Il faut retirer des incitations à voter en groupe et dans un intérêt personnel de réélection toujours grandissant.
Il y a d’autres mesures, comme regarder de plus près les conflits d’intérêts, surveiller les renvois d’ascenseur pour les nominations, limiter les parachutages lors des candidatures aux élections, et plus globalement retirer un maximum de possibilités de s’assurer une carrière au détriment de l’intérêt national.
Ce sera un combat permanent et jamais gagné, mais nous avons déjà des choses évidentes par lesquelles commencer. À commencer peut être déjà par arrêter d’élire tous ceux qui se contentent de voter en fonction du critère majorité / opposition et pas en fonction du contenu des textes.
-
Je ne veux pas de médailles littéraires monsieur Pivot
Monsieur Pivot,
J’ai un profond respect pour le travail que vous avez effectué et que vous effectuez toujours autour de la langue, de la littérature et de l’écriture. Il y a un grand honneur à défendre des valeurs intemporelles tout en restant ouvert aux nouveautés. Aussi futile que cela puisse être, vous voir investir twitter de manière éclairée est rafraîchissant en cette période de clivage entre « le numérique est l’avenir » et « le numérique est dangereux ».
Quand je vous lis vouloir défendre la librairie ; je tends l’oreille. Tels qu’ils sont rapportés, vos propos récents m’ont fait trembler de tristesse.
« Nous avons toute une politique du livre que la ministre et le président du CNL ont raison de mener », observe le récent président de l’Académie Goncourt. Et à ce titre que pourrait faire l’Académie pour apporter sa petite pierre à ce grand édifice ? « En couronnant de bons livres. En couronnant des livres qui se vendent très bien », exulte, dans un franc sourire, Bernard Pivot.
« Regardez le dernier, [Pierre Lemaître, Au revoir là-haut, publié chez Albin Michel], il en est à plus de 500.000 exemplaires ! » Selon les données Edistat, ce sera plutôt presque 300.000 exemplaires, en réalité. Mais on comprend l’idée. « Les libraires sont plutôt contents que l’on ait couronné un livre qui se vend à 500.000 exemplaires, plutôt qu’un livre qui se serait vendu à 50.000 exemplaires. Notre action elle est là, elle n’est pas ailleurs. »
Est-ce donc là toute la mission de la librairie ? Le meilleur soutien qu’on puisse apporter à la librairie est-il de sacraliser et d’ajouter des rubans rouges à ces livres qui se vendent si bien ?
On enterre là totalement la librairie, et le libraire encore plus profond. Si ces derniers n’ont pour seul rôle que de mettre en avant les meilleures ventes et d’en assurer la distribution, quel service rendent-ils ? Pourquoi n’irais-je pas au supermarché ou sur Internet pour acheter le même livre ? Je n’ai que faire d’un magasin dédié si c’est uniquement pour acheter les meilleures ventes.
Si notre seule vision de la librairie est une autorité qui décerne les disques d’or en fonction de leurs ventes passées ou probables afin de mieux accrocher des médailles aux livres dans les vitrines des librairies, c’est certain que le numérique n’a pas sa place. On aidera encore quelques temps les libraires à attirer les badauds, mais ils finiront par mourir par manque de valeur ajoutée pour le lecteur.
Je vous pensais défenseur de la littérature. Les meilleures ventes en font partie, incontestablement. Sauf à considérer que tous les lecteurs sont des imbéciles, on peut même affirmer que les fleurons de la littérature se retrouveront le plus souvent dans ces meilleures ventes.
Maintenant, où sont la découverte et le conseil ? Où est le soutien à la richesse et l’étendue de la littérature ? aux coups de cœur, à la capacité d’avoir en stock justement autre chose que les cinquante meilleures ventes qui seront primées ? Où est la capacité de livrer à domicile ? Comment renouveler l’interaction entre le libraire et le lecteur à l’heure où la communication passe de plus en plus en ligne ? Comment la librairie peut-elle participer à l’arrivée du numérique et y apporter sa valeur ?
Voilà les questions que j’aurais aimé vous voir aborder. Ajouter un prix littéraire de plus à un paysage qui n’en compte que trop, cela ne va que renforcer le fossé entre l’offre librairie et les attentes des lecteurs. Le TOP 50 n’a jamais aidé les disquaires à vivre leur mutation, il les a au contraire enchaînés dans un modèle totalement déphasé par rapport à leur époque.
À l’inverse, si on voit le libraire comme un prescripteur, quelqu’un qui découvre, fait découvrir, qui conseille, y compris et surtout justement en dehors des sentiers battus et des grands prix littéraires pour lesquels personne n’a besoin de lui, quelqu’un qui sait trouver le livre adapté au lecteur en fonction de son caractère et d’un échange sur la littérature, alors peut-être que nous aurons une vraie défense de la librairie à long terme.
Et dans cette vision, on se moque bien que le livre soit en papier et en numérique. Par contre le numérique peut apporter des formats différents. Il peut permettre de remettre les nouvelles et les textes courts au goût du jour. Il peut permettre de publier des ovnis littéraires qu’il serait risqué de publier immédiatement en papier.
« Oh, je ne crois pas. À mon avis non. Nous lisons des livres sur papier. Les bons livres… ils peuvent être numériques… mais ils seront toujours sur papier. Je ne crois pas à cette histoire du livre qui ne serait que numérique et qui n’aurait pas de version papier. Je ne crois pas du tout à cela. »
Je vais prendre le contre-pied. Les bons livres… ils peuvent être sur papier… mais ils seront toujours en numérique. Tout simplement parce qu’il n’y a aucune raison pour qu’un bon livre ne soit pas publié aussi en numérique.
Par contre le numérique et son faible coût de publication peuvent entrainer un foisonnement, une richesse qu’on n’a jamais vus en papier et qu’on ne pourra jamais voir. Il s’agit de la littérature ouverte à tous pour la lecture mais aussi pour l’écriture. Il y aura du mauvais, voire du très mauvais, mais il y aura aussi du bon voire du très bon qui n’aurait pas éclos sans cette facilité.
Le numérique c’est aussi la possibilité de renouveler les formats en publiant des nouvelles et formats courts, oubliés des librairies et des éditeurs. C’est aussi la possibilité de sortir tant de textes trop risqués en édition papier, de la poésie au nouveau roman en passant par des ovnis trop décalés pour imaginer les mettre en tête de gondole dans les magasins.
Nous avons eu une grande révolution en passant des livres recopiés manuellement à l’imprimerie, une petite révolution avec l’avènement du poche. Chacune a permis d’élargir la littérature, sa diffusion, et sa richesse. Ce que le numérique promet, c’est un élargissement d’un ordre de grandeur supérieur.
Personne n’en veut au papier, pas plus que le poche n’a fait disparaître le grand format, mais si on enseigne aux libraires que là n’est pas leur avenir, ils vont se contenter de faire du commerce d’arbres morts découpés en fines lamelles, plus ou moins mis en avant en fonction du nombre de leur passages à la TV ou de médailles littéraires… et finir par mourir.
Permettons-leur de ne plus vendre du papier mais de conseiller de la littérature. Là non seulement le support n’est pas primordial, mais il est évident qu’il y aura un bouillonnement dans le numérique qu’il serait suicidaire de laisser à Amazon.
-
Ping pong
Je partage peu de bêtises mais ce match de ping pong est un indispensable à regarder pour vous remonter le moral :
-
y vais-je ou n’y vais-je pas ?
Vous voulez faire avancer le débat anti-ivg ? Commencez par traiter vos interlocuteurs avec respect et écoutez-les.
Ça me fait mal de le dire, mais autant je suis en désaccord avec eux, autant ils ont un discours bien plus sensé et argumenté que la plupart de leurs interlocuteurs.
Ce que je veux dire ? Les anti-ivg considèrent simplement que le foetus est un être vivant, un petit humain dès que l’ovule a été fécondée. Ils ne sont pas tous forcément contre le choix de la mère à être mère, contre le choix d’enfanter ou pas, contre le contrôle de son propre corps. Ils jugent par contre le plus souvent cet éventuel choix ne donne pas le droit de tuer un humain.
Les appeler anti-choix, prétendre qu’ils veulent contrôler l’uterus des autres femmes ou autres arguments de ce type, c’est juste passer à côté des deux questions centrales :
- À partir de quel moment l’enfant à naître est-il un enfant, ou plus généralement un humain à part entière ?
- Si on accepte que l’enfant à naître puisse être un humain à part entière avant de sortir du corps de sa mère, comment traiter l’équilibre entre les droits de la mère et de l’enfant à naître ?
Le pire est de les appeler anti-droit, parce que là c’est clairement vous qui n’avez rien compris au débat : Eux aussi se battent *pour* les droits de tiers.
Il est évident qu’il sera vain de discuter avec certains. C’est vrai autant pour les anti-ivg que pour les pro-ivg. Maintenant si vous voulez faire avancer le débat, discutez et argumentez sur le statut du foetus et sur l’équilibre des droits.
Oh, et si vous croyez que ces questions sont simples, qu’il est évident ou prouvé scientifiquement que le statut d’humain s’acquiert à telle ou telle période, ou qu’il est évident que… c’est que vous avez probablement encore à bosser un peu votre sujet avant de reprocher leur opinion aux autres.
Oui je ne soutiens pas ce qu’il est en train de se passer en Espagne, mais en niant ou en faisant semblant de ne pas comprendre la vision des anti-ivg, certains pro-ivg sont en train de faire bien plus de mal que de bien à notre cause.
Typiquement, je trouve ce niveau d’argumentation non seulement ne fera rien avancer ni personne, mais en plus risque d’avoir l’effet contraire de celui recherché.
-
Politique culturelle : numérisation du patrimoine
Petite vision de ce qu’il se fait en Norvège et comparaison avec le système ReLire français.
Les deux projets ont pour objectif de numériser les livres publiés dans leur pays avant 2001 pour leur redonner une vie et assurer la diffusion du patrimoine culturel.
Les similarités s’arrêtent ici.
La Norvège finance une numérisation publique, et en donne ensuite un accès public (uniquement aux administrés), gratuitement. Seuls les auteurs sont rémunérés, de façon forfaitaire. Ceux qui veulent s’en exclure le peuvent.
La France subventionne les numérisations qui seront faites par les éditeurs, et en donne ensuite l’exploitation aux éditeurs, exploitation qui ne pourra pas être gratuite. Les bénéfices vont à moitié pour l’éditeur et pour les auteurs (via une gestion collective) après remboursement des frais de numérisation (donc les non rentables ne touchent rien). Ceux qui veulent s’en exclure ont six mois pour le faire à partir d’une date qu’on ne leur annonce pas.
Il y a comme une différence flagrante dans la vision de la mission des deux bibliothèques nationales ou des deux ministères de la culture. Les deux visions ont des motivations respectables, mais elles sont totalement opposées
Il y a aussi du très positif à signaler : La BNF a annoncé l’ouverture de sa base bibliographique, et ça c’est un très grand pas dans la bonne direction.
-
Entendu sur les 35h
Les 35h ont été globalement profitables et aux salariés et aux entreprises. Ceux qui y ont perdu ce sont tous les autres.
Le problème étant que le passage à marche forcé aux 35h s’est fait majoritairement via des gains de productivité et l’arrêt des activités peu rentables. Ce gain a été partagé entre les entreprises et les salariés, mais n’a que très peu entraîné d’embauches. L’écart se creuse donc entre ceux qui bénéficient d’un emploi et ceux qui n’en n’ont pas. Socialement ça reste un problème.
Attention toutefois à ne pas en tirer que la réduction du temps de travail était une idiotie. Le problème résulte de la réalisation, pas de l’objectif.
Étude comparée
L’occasion a été de fouiller un peu les chiffres de l’OCDE pour voir un peu si nos 35h sont totalement anachroniques et qu’il faut viser à travailler plus comme le disent certains.
Premier tour statistique, entre 2000 et 2012, sur les 37 pays de l’OCDE, le temps de travail annuel par travailleur a baissé dans tous les pays sauf la Belgique (qui note une augmentation de 2%). Tous. Allemagne, Royaume Uni et États Unis compris.
Non seulement nous ne sommes pas isolés mais notre baisse est nettement inférieure à celle de l’Allemagne ou de la moyenne de l’OCDE, similaire à celle du Royaume Uni et des États Unis.
Second tour entre 1997 et 2012 pour prendre une référence avant les lois sur les 35h et le résultat est similaire (cette fois ci c’est la Russie qui fait exception avec 2% d’augmentation).
En lançant une analyse sur l’ensemble des données qui remontent jusqu’à 1950 pour certains pays, on voit que la baisse moyenne sur les pays de l’OCDE est constante et ininterrompue.
Pour ceux qui aiment bien comparer avec l’Allemagne, nous avons toujours eu un temps de travail annuel plus important qu’eux, et cette différence se creuse. Proportionnellement, l’écart n’a jamais été aussi important que ces quatre dernières années.
Seuls quelques pays ont eu ponctuellement un temps de travail annuel inférieur à 2012, et avec un écart rarement supérieur à 2% (seules exceptions : La Suède dans les années 80, La La Russie dans les années 90 et la Slovaquie en 2003).
Choix du modèle de société
Bref : Nous travaillons de moins en moins. Les 35h ne sont qu’une organisation sociale de cette baisse, certainement pas la cause. Ce qui est inquiétant c’est plutôt que nous ne réfléchissions pas à la suite, parce que ça va encore baisser.
L’étude OCDE indique le temps de travail annuel moyen par travailleur (salarié ou non, plein temps ou non). Il ne prend pas en compte les gens qui ne travaillent pas. Une différence majeure tient donc dans la répartition de ce travail sur l’ensemble de la population :
Le travail est-il réservé à quelques happy few qui trustent tout le temps de travail et donc aussi toute la richesse, ou le travail et la richesse sont-ils mieux réparti sur l’ensemble de la population quitte à ce que chacun travail et gagne un peu moins ? On se posait peu la question il y a cinquante ans mais avec les taux de non-emploi actuels, il s’agit bien du cœur du sujet.
Inciter les gens à travailler plus individuellement, ou freiner la baisse du temps de travail individuel (que ce soit en temps de travail hebdomadaire, ou en absences pour formation et congés), c’est indirectement choisir le premier modèle des deux. Ce n’est pas forcément ma vision d’une société (et finira forcément par éclater si nous avançons durablement sur ce chemin).
-
Sénat : agenda du 20 janvier sur la géolocalisation
Références :
- Projet de loi
- Étude d’impact et motivations
- Amendements proposés
Sur la solution retenue
L’étude d’impact justifie le besoin de ne pas avoir un avis préalable d’un juge mais rien dans cette même étude ne justifie une autorisation pleine et sans contrôle sur 15 jours.
Une telle autorisation ne répond d’ailleurs pas au motif même du projet de loi qui est que la géolocalisation temps réel « constitue une ingérence dans la vie privée dont la gravité nécessite qu’elle soit exécutée sous le contrôle d’un juge » (sauf à considérer qu’une géolocalisation temps réel d’un dispositif autre que téléphone portable est une ingérence plus faible que sur un téléphone portable).
Une présomption d’autorisation à faire valider dans les 48h par le JLD peut tout à fait être mise en place. Elle permettra au procureur d’agir immédiatement sans être contraint tout en permettant la garantie d’une validation par un juge tiers.
C’est cette option qui nécessiterait d’être mise en place, et c’est d’ailleurs celle retenue dans l’Art. 230–35.
Sur le périmètre de l’autorisation de 15 jours
Le texte tel quel permet au procureur de pister tour à tour plusieurs objets sur une période de 15 jours pour au final pister une personne sur une période bien plus longue, ce sans contrôle d’un juge ni recours.
Il est essentiel que la durée de 15 jours s’applique à la finalité de la géolocalisation, et pas à l’objet géolocalisé.
Sur l’amendement COM-2
Le vote positif à l’amendement COM-2 est essentiel. Les dispositifs techniques peuvent être éteints ou allumés potentiellement à volonté. Sans cet amendement il serait alors possible de contourner la durée de 15 jours en ne faisant des requêtes que sur demande.
Il faudrait même aller plus loin et ajouter que la date de début de l’opération de géolocalisation ne peut être considérée comme postérieure à la mise en place du dispositif destiné à l’enquête en cours ou à son activation s’il s’agit d’une possibilité pré-existante à l’enquête.
Si un dispositif nécessite une mise en place sur une durée de plus de quinze jours, nous ne sommes plus dans des urgences et besoins de réactivité qui nécessitent de travailler sans en référer au JLD
Sur l’amendement COM-3
Le déroulé d’un procès un domaine de compétence qui m’est étranger mais je trouve risqué l’amendement COM-3. Si l’absence des premières mesures est justifié, l’absence de description du moyen technique utilisé ou de sa position est de nature à permettre des erreurs judiciaires. Elle ne permet en effet pas au défenseur de vérifier ou démontrées de potentielles erreurs de position (moyen technique non adapté ou non fiable sur ce cas précis) ou d’interprétation (objet ciblé qui a pu à un moment se trouver séparé du dispositif de mesure, etc.).
J’ai bien vu la modification à l’Art. 230–43 mais les positions continueront à faire poids dans la procédure alors qu’elles sont potentiellement erronées et non contestables. J’y vois un problème et un risque majeur.
Sur l’autorité judiciaire
L’étude ne fait étonnamment pas référence à l’arrêt « Medvedyev 1 » de la CEDH, qui pourtant est tout à fait pertinent ici. Ce dernier remet en cause la pertinence de considérer le parquet français comme une autorité judiciaire (au sens de la CDH) indépendante et légitime à autoriser des mesures privatives de libertés. Le fait que la constitution le considère comme tel (ce qui est explicité dans l’étude d’impact) ne prime pas sur la CEDH.