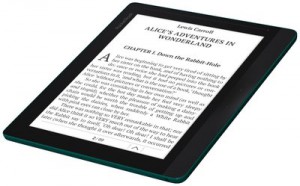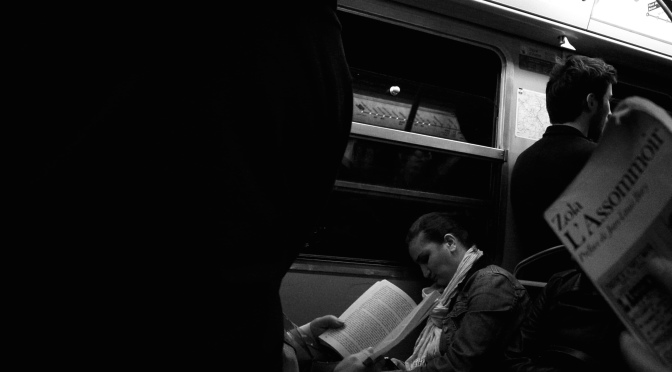Une liseuse pour Noël ? oui mais laquelle ?
–> Allez plutôt voir la nouvelle recommandation pour l’hiver 2015 – 2016 <–
Lire partout, souvent
Votre amour lit des romans, des nouvelles, des séries, essentiellement du texte. Le numérique lui permettra de lire dans les transports, dans la salle d’attente de votre médecin, sur un banc public, ou chez lui sur votre canapé et dans votre lit.
 Il lui faut quelque chose qui tient dans la poche, avec un écran qui reste lisible en pleine lumière et une autonomie longue sans recharger. L’encre électronique est indispensable, oubliez les tablettes LCD.
Il lui faut quelque chose qui tient dans la poche, avec un écran qui reste lisible en pleine lumière et une autonomie longue sans recharger. L’encre électronique est indispensable, oubliez les tablettes LCD.
Le cadeau sympa est la Pocketbook Sense. Elle est vendue dans une édition limitée siglée Kenzo, accompagnée d’une couverture intégrée avec un rendu façon cuir crocodile franchement sympa. En alternative vous aurez les Aura et Aura H2O de chez Kobo.
Laquelle ?
Les trois sont de bonnes liseuses, avec les mêmes classiques : design sympa, tactiles, bon contraste de lecture, possibilité de sur-éclairage, ouverture des livres au format epub avec ou sans drm, un dictionnaire intégré, et librairie embarquée qui donne accès à l’intégralité du catalogue français disponible.
La Sense est ma préférée, l’édition limitée Kenzo est superbe pour un cadeau : la couverture est sympa, la griffe Kenzo discrète, et la couverture vraiment collée à la liseuse au lieu de rajouter une sorte de sur-emballage comme partout ailleurs. La Sense a aussi l’avantage de garder des boutons physiques pour tourner les pages en plus de l’écran tactile. Ça rassure au départ pour ceux qui viennent du papier et ça permet de fonctionner l’hiver avec des gants pendant les transports. Les plus technophiles y trouveront une synchronisation des livres avec leur compte Dropbox : appréciable même si pas indispensable.
La Aura simple est très proche de la Sense, même format compact malgré l’écran classique de 6″. Une superbe promotion pour Noël la met à 100 €, mais une fois que vous ajoutez la couverture – indispensable – vous remontez au même prix que la Sense by Kenzo sans avoir le côté « intégré » de la couverture. Le choix Aura se révèlera surtout pertinent si acheter des livres en anglais directement depuis la liseuse est indispensable pour vous (sinon vous pourrez toujours le faire depuis le web).
Quant à la Aura H2O, on monte significativement en gamme. Ça se ressent à la lecture, mais aussi sur le portefeuille : Plus de 200 € si on ajoute la couverture – et à ce prix, qui a envie de risquer une rayure ? Elle a aussi un format un peu plus grand, intéressant pour lire, mais qui devient trop large pour pas mal de poches. Plus qualitative, mais du coup un peu moins mobile.
Et le reste ?
Je déconseille les liseuses bas de gamme premier prix. On sacrifie la qualité de l’écran, le sur-éclairage, et l’expérience de lecture s’en ressent. Au final ça aura tendance à rester sur l’étagère, voire à faire rejeter la lecture numérique.
Évitez aussi les Kindle. Même si la Paperwhite est un excellent matériel, vous entrez dans un environnement qui s’apparente à une prison dorée : Vous ne pourrez pas sortir vos livres de l’environnement Kindle, ni importer la plupart des livres achetés ailleurs. Le jour où vous voudrez sortir de l’écosystème Amazon, vous devrez abandonner tous vos achats. Inacceptable.
Littérature, dans le lit et le canapé
Votre amour lit à domicile, sur le canapé ou dans le lit. Pas vraiment besoin de se déplacer avec la liseuse en poche. Vous pouvez garder la recommandation précédente – qui restent très bien – ou investir un peu plus pour des modèles plus grand format et plus qualitatifs.
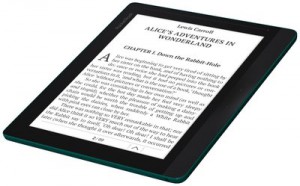 Celle que je vous conseille est la Pocketbook Inkpad. Elle a une très haute résolution (250 point par pouce, c’est à dire mieux que les liseuses « haute définition » habituelles) et une surface d’affichage équivalente à un livre grand format (8″). Bref, elle avance là où c’est le plus important : la qualité de lecture. Elle aura sinon tous les avantages de la Sense citée plus haut, plus la sortie audio qui permet entre autres les mp3 et la synthèse vocale (text to speech).
Celle que je vous conseille est la Pocketbook Inkpad. Elle a une très haute résolution (250 point par pouce, c’est à dire mieux que les liseuses « haute définition » habituelles) et une surface d’affichage équivalente à un livre grand format (8″). Bref, elle avance là où c’est le plus important : la qualité de lecture. Elle aura sinon tous les avantages de la Sense citée plus haut, plus la sortie audio qui permet entre autres les mp3 et la synthèse vocale (text to speech).
La seule autre que je recommande est la Kobo Aura H2O : écran à fort contraste et très haute définition, elle gagne aussi une résistance à l’eau (notez le signe « H2O », sans ce dernier il s’agit de modèles de taille ou de génération/qualité différente). Elle est par contre d’une taille plus réduite (6,8″ pour la H2O contre 8″ pour la Inkpad). À vous de voir si vous privilégiez la surface de lecture ou la taille pour le rangement.
Et le reste ?
Les grands formats sont encore rares, et le choix plus que limité. La seule alternative crédible est la Cybook Ocean. C’est une 8″, mais avec un écran basse densité produit par un concurrent de e-ink (l’usine qui fournit l’ensemble des écrans à encre électronique haute qualité, sur toutes les liseuses citées jusqu’à présent). Elle n’est pas vraiment moins chère de toutes façons.
N’hésitez toutefois pas à jeter un oeil aux formats 6″ classiques décrits plus haut. La lecture y reste tout à fait confortable. Pour lire dans le lit j’aurais même tendance à conseiller un format 6″ qui tient facilement en main (taille d’un livre de poche).
Bandes dessinées, jeunesse, et hors littérature (cuisine, photo)
Pour les illustrés il vous faudra quitter les liseuses à encre électronique. Il y a bien eu de l’encre électronique couleur chez Pocketbook mais vous n’aurez pas l’éclat attendu pour apprécier la lecture.
Vous pouvez chercher dans les tablettes LCD classiques, pas forcément spécifiques au livre. Privilégiez un écran de très bonne qualité et haute résolution. 
Pour de la BD belge classique, préférez une tablette 9 ou 10″ qui aura la surface utile pour ne pas avoir à zommer sur chaque case. La Nexus 9 a de loin le meilleur rapport qualité/prix. Oui, ça fait presque 400€ mais ça les vaut. Plus petit ça sera difficile pour tout ce qui n’est pas littérature.
Côté concurrence il y a les les iPad, mais ça vaut encore plus cher. Fuyez les tablettes premier prix (disons celles qui valent moins de 60/50% des prix que je vous donne) et faites attention aux autres (le prix ou une marque connue ne sont pas toujours révélateurs d’un contenu de qualité).
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous aider du comparatif automatisé : Il vous construit une recommandation à partir de vos propres critères
Rappel : J’ai un emploi partie prenante dans le domaine de la distribution de livre numérique. Je ne prétends donc pas être objectif, mais je ne fais que des conseils que je soutiens personnellement, pas de la publicité. À vrai dire c’est justement parce que je crois en une solution que je travaille avec, pas l’inverse. Ces recommandations sont données à titre purement personnel, justement parce que j’ai eu la chance de tester moi-même les différents modèles que je recommande.
Photo d’entête sous licence CC BY-NC-ND par Saad Sarfraz Sheikh