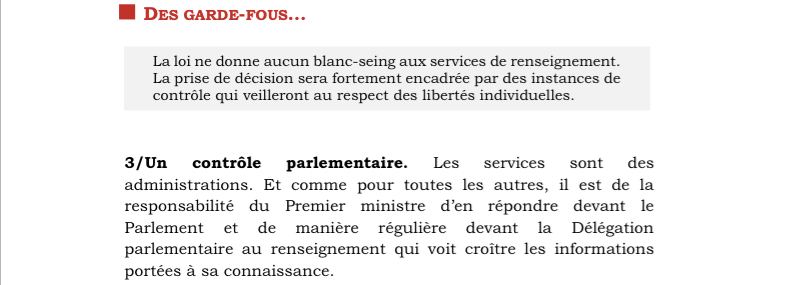Le PS vient de publier son argumentaire marketing pour le soutien au projet de loi renseignement. Décodage.
Le PS vient de publier son argumentaire marketing pour le soutien au projet de loi renseignement. Décodage.
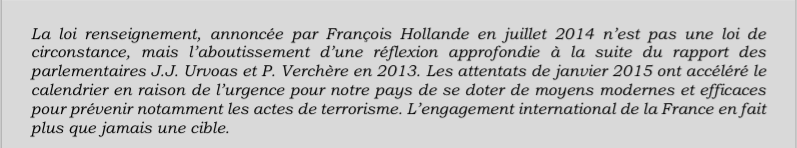 Le fait que les attentats de janvier 2015 n’auraient probablement pas été empêchés avec la surveillance que nous prévoyons ici ne semble interpeler personne.
Le fait que les attentats de janvier 2015 n’auraient probablement pas été empêchés avec la surveillance que nous prévoyons ici ne semble interpeler personne.
En réalité le rapport de 2013 a déjà mené à la loi de programmation militaire de fin 2013, avec déjà des dispositions largement limite vis à vis des libertés publiques et particulièrement de la liberté d’expression.
Il s’agit juste ici de profiter de l’indignation pour faire passer d’autres dispositions que l’opinion politique n’accepterait jamais à froid. Il y a donc effectivement urgence, mais pas celle qu’on croit.
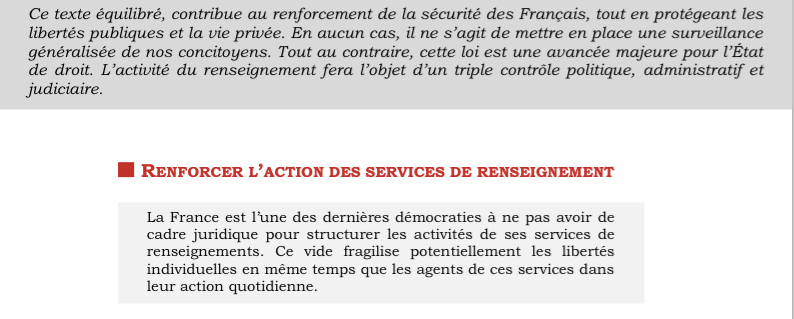 Il n’y avait aucun « vide », juste des lois que les services de renseignement ne respectaient pas, en toute impunité. On avouera que c’est nettement différent. On peut dire que ça fragilisait l’activité des agents, de la même manière que l’interdiction du vol fragilise l’activité des voleurs.
Il n’y avait aucun « vide », juste des lois que les services de renseignement ne respectaient pas, en toute impunité. On avouera que c’est nettement différent. On peut dire que ça fragilisait l’activité des agents, de la même manière que l’interdiction du vol fragilise l’activité des voleurs.
En tout état de cause, cela ne fragilisait en rien les libertés individuelles, qui elles étaient justement pleinement protégées. C’est justement ce qui va changer.
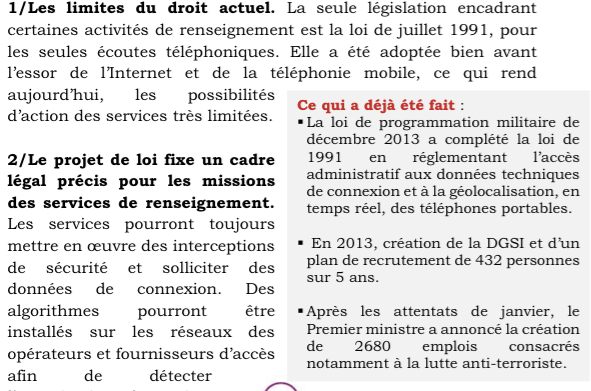 Donc, reprenons : On nous dit qu’il y a un vide qu’il est urgent de remplir, avant de nous dire qu’en fait non il y a bien un cadre existant au moins depuis 1991 mais limité car ne prévoyant pas la téléphonie mobile, et ce malgré l’encart qui rappelle le cadre de 2013 qui autorise l’accès à toutes les données techniques de connexion et à la géolocalisation en temps réel des téléphones portables.
Donc, reprenons : On nous dit qu’il y a un vide qu’il est urgent de remplir, avant de nous dire qu’en fait non il y a bien un cadre existant au moins depuis 1991 mais limité car ne prévoyant pas la téléphonie mobile, et ce malgré l’encart qui rappelle le cadre de 2013 qui autorise l’accès à toutes les données techniques de connexion et à la géolocalisation en temps réel des téléphones portables.
Vous le voyez qu’on essaye de nous enfumer là ? Trois paragraphes qui se suivent, qui contredisent chacun l’argument précédent.
Le problème n’est pas de fixer un cadre. Il n’est pas non plus celui de la téléphonie mobile. Le problème c’est d’autoriser ce qui était explicitement illégal, donc aller installer des outils d’analyse de masse directement chez les opérateurs.
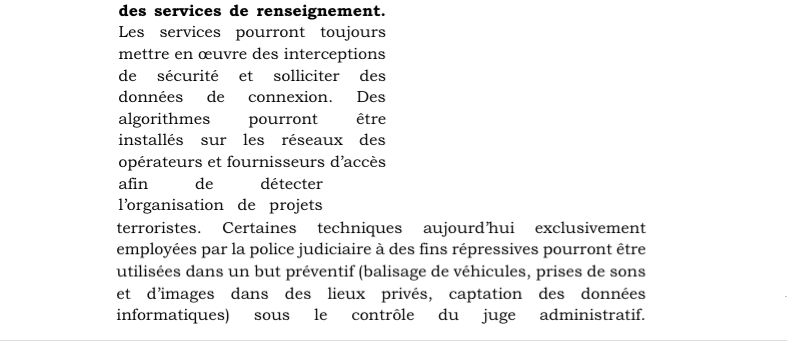 Il y a 10 ans, on aurait parlé de pédopornographie pour faire peur. Aujourd’hui c’est de terrorisme. Donc, on parle de terrorisme, oui, mais aussi (entre autres) :
Il y a 10 ans, on aurait parlé de pédopornographie pour faire peur. Aujourd’hui c’est de terrorisme. Donc, on parle de terrorisme, oui, mais aussi (entre autres) :
Des intérêts essentiels de la politique étrangère et de l’exécution des engagements européens et internationaux de la France
Dit autrement, si l’exécutif français s’engage dans un traité international ou européen, elle peut surveiller tout ce qui risque de le mettre en échec. Nucléaire, copyright, économie… pas vraiment de limite.
Les intérêts économiques et scientifiques essentiels de la France
On parle d’espionnage économique et scientifique de base, mais aussi plus généralement de tout ce qui peut entraver ce que l’exécutif considère comme l’intérêt de la France à ce niveau. Tiens, une organisation écologique qui milite contre la politique nucléaire, que la France a toujours considéré comme au coeur de son intérêt national économique et scientifique… Plus vraiment du terrorisme là.
La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées
Pas vraiment du terrorisme là. La prévention de la délinquance, fut-elle organisée, ça peut toucher quasiment tout le monde (éventuellement par erreur).
La prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique
Celui là est le plus joli, car il permet de cibler l’essentiel des activités syndicales liées à des manifestations.
Attention ! Tous ces motifs ne concernent pas des faits avérés mais de la prévention. Il n’y a donc pas besoin d’avoir été l’auteur de violences collectives, de délinquance organisée, ou d’intérêts économiques.
On parle de prévention, c’est à dire qu’il suffit que l’exécutif pense – arbitrairement – que la surveillance en question puisse peut être l’aider à savoir quelque chose qui permettra de prévenir un problème. Si vous croyez que ça ne vous concerne pas, relisez la phrase précédente.
Quand on parle du Premier Ministre qui en répond devant le parlement, ça veut dire que ça repose sur la possibilité pour le parlement de voter une motion de censure afin de renverser le Premier Ministre de sa propre majorité. Étant donné le fonctionnement de la Vème république, c’est super rassurant comme garde-fou, non ?
Sachant que dans le cas extrêmement improbable où ça arrive, ça n’arrête aucune action entreprise dans le cadre de la présente loi, ça permet juste la nomination d’un nouveau Premier Ministre.
Vous le sentez bien le garde-fou pour vos libertés ?
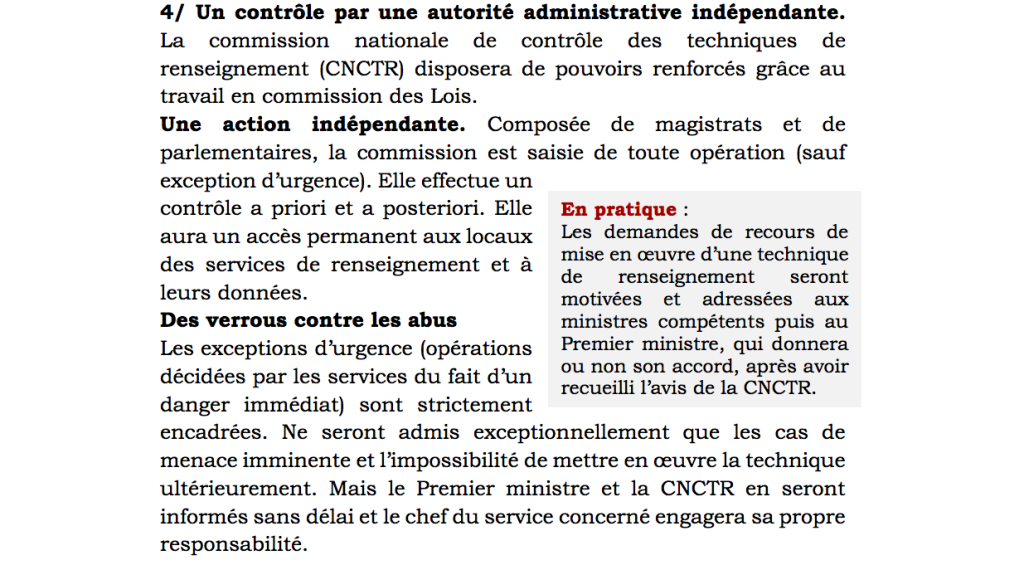 Ah, la commission de contrôle. Une des motivations de ce projet de loi est plus ou moins officiellement que les services de renseignement exécutent déjà une partie de ces actions, de façon tout à fait illégale, et qu’il faut leur donner un cadre légal (en gros : légaliser leurs actions illégales).
Ah, la commission de contrôle. Une des motivations de ce projet de loi est plus ou moins officiellement que les services de renseignement exécutent déjà une partie de ces actions, de façon tout à fait illégale, et qu’il faut leur donner un cadre légal (en gros : légaliser leurs actions illégales).
Ils sont déjà surveillés par la commission de contrôle avec des magistrats et des parlementaires. Le rapporteur du projet de loi en question fait justement partie de la commission actuelle qui ne trouve visiblement rien à y redire et n’a pas empêché ces dérives. C’est dire combien le verrou contre les abus est au centre des préoccupations…
Ça y est, vous vous sentez protégés ?
Oh, et on vous a dit que le président de la commission de contrôle actuelle s’est exprimé dans la presse pour dire que ce nouveau texte affaiblirait le contrôle sur l’activité de renseignement ? Elle rassure cette commission de contrôle, hein ?
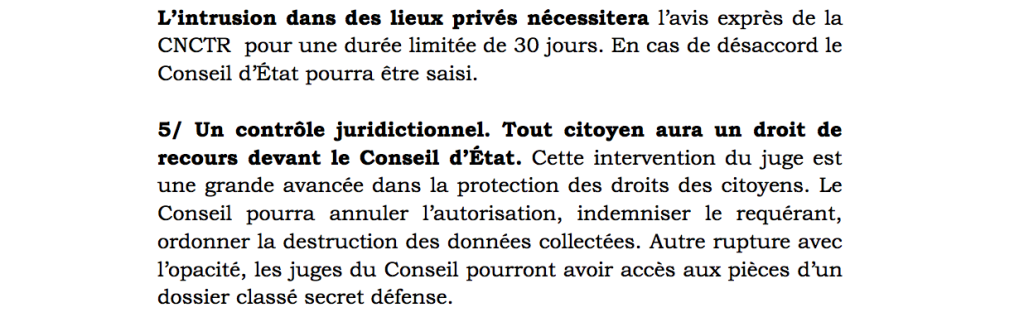 Là on est limite dans la farce. Donc vous aurez un droit de recours devant le Conseil d’État si vous êtes la cible de surveillances.
Là on est limite dans la farce. Donc vous aurez un droit de recours devant le Conseil d’État si vous êtes la cible de surveillances.
Oh, bien sûr pour ça il faudra savoir puis prouver que vous êtes la cible d’une surveillance, qui par nature ne sera jamais publique. Autant dire que c’est de pure forme. Tout au plus ça peut servir à un cas tous les trois ans, et uniquement après que le dommage ait eu lieu.
Le reste est à l’avenant, avec un tableau de pure mauvaise foi à la fin.
Alors, rassuré par le document du PS ?