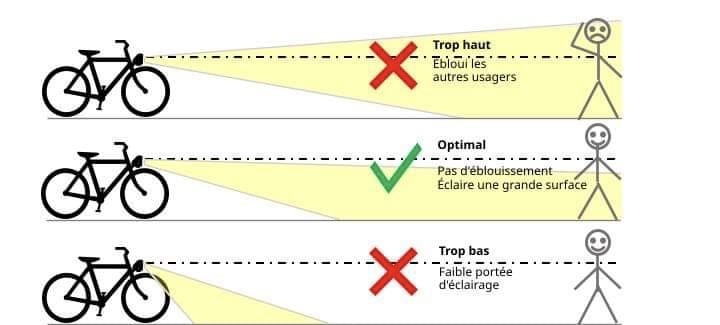L’idée c’est de parcourir cas à cas, dans l’ordre, et de s’arrêter au premier qui correspond.
Cas général
Il y a des places de stationnement libres ? ✅ Utilisez-les. Ne faites pas de double file, n’occupez pas la bande cyclable.
Il y a une place de livraison avec ligne discontinue ? ✅ Vous pouvez vous y arrêter temporairement ici (mais pas y stationner).
Il y a un accotement praticable non réservé aux piétons ou cyclistes ? ✅ Vous pouvez vous y arrêter.
Sinon, ❌ Allez plus loin. Trouvez une place disponible, quitte à marcher un peu. En agglomération il y a quasiment toujours une place en surface ou une place en sous-terrain à moins de 250 mètres.
C’est vraiment pour deux minutes
(en plus des cas précédents)
La voie à droite va dans le même sens de circulation ? ✅ Arrêtez-vous sur la voie de circulation générale la plus à droite. Les autres automobiles vous contourneront par la gauche.
La voie à droite est séparée par une ligne discontinue ? ✅ Arrêtez-vous sur la voie de circulation générale la plus à droite. Les autres automobiles vous contourneront par la gauche.
C’est un sens unique avec la place de se croiser et il y a une bande cyclable à droite ? ✅ Arrêtez-vous à gauche de la chaussée. L’article R417–1 vous permet de vous arrêter à gauche dans ce cas.
Attention à ne jamais empiéter vous arrêter sur la gauche d’une chaussée qui contient un double-sens cyclable (mais dans ce cas ce n’est pas un sens unique, par définition c’est un double sens même s’il n’est pas accessible aux automobilistes dans les deux sens). C’est un danger de mort pour les cyclistes.
Sinon, ❌ Allez plus loin. Trouvez une place disponible, quitte à marcher un peu. En agglomération il y a quasiment toujours une place en surface ou une place en sous-terrain à moins de 250 mètres.
C’est vraiment pour 15 secondes ? ⚠️ Vous ne devriez pas, mais arrêtez-vous sur votre voie sans déborder sur des voies réservées. Si c’est vraiment court, les autres attendront.
Dans tous les cas : Laissez libre la voie bus ou la bande cyclable à votre droite. Ne l’occupez pas. En plus d’être dangereux pour les cyclistes, ce serait un arrêt « très gênant » et vous coûterait 135 € (article R417–11).
Je n’ai vraiment pas le choix (une panne ?)
(en plus des cas précédents)
⚠️ On parle dorénavant de cas de force majeure. Si vous avez le choix et que votre arrêt n’est pas indispensable, vous risquez au moins une amende de 35 € pour « arrêt gênant » (article R-417–10).
La voie à droite est une voie réservée pour les bus ? ⚠️ Arrêtez-vous sur la voie générale la plus à droite. Les autres automobilistes feront un contournement exceptionnel par la voie bus. Ils n’y seront pas prioritaires et ne créeront pas de danger.
Il y a une voie à gauche, séparée par une ligne continue ? ⚠️ Arrêtez-vous sur la voie générale la plus à droite. Les autres automobilistes feront un contournement exceptionnel par la voie bus. Ils n’y seront pas prioritaires et ne créeront pas de danger.
Il y a une place de livraison avec ligne continue ? ⚠️ Vous ne devriez pas vous y arrêter, mais c’est encore là que vous gênerez le moins si vous n’avez vraiment pas le choix. Laissez par contre les places de transport de fond de libres, là il y a un enjeu de sécurité pour le personnel concerné.
C’est un sens unique ou un double-sens cyclable et, il n’y a pas la place à deux automobiles de se croiser ? ⚠️ Arrêtez-vous sur la voie générale. N’empiétez pas sur la voie cyclable. Ça ne sert à rien de toutes façons vu que les automobilistes ne pourront quand même pas vous contourner.
Il y a une bande cyclable à droite plus un double sens cyclable à gauche et la totalité de la chaussée permet à deux automobiles de se croiser ? ⚠️ À défaut de mieux, ici et seulement ici, si l’arrêt est à la fois indispensable et long, il n’y a de meilleure solution que vous placer à droite de la chaussée empiétant sur la bande cyclable de droite.
Attention à ne jamais empiéter vous arrêter sur la gauche d’une chaussée qui contient un double-sens cyclable. C’est un danger de mort pour les cyclistes.
Dans tous les cas sauf le dernier : Laissez libre la voie bus ou la bande cyclable à votre droite. Ne l’occupez pas. En plus d’être dangereux pour les cyclistes, ce serait un arrêt « très gênant » et vous coûterait 135 € (article R417–11).
L’amende de 35 € en cas d’arrêt sur la voie générale (« arrêt gênant ») sera de toutes façons moins chère que celle de 135 € en cas d’arrêt sur voie réservée (« arrêt très gênant »).
Cette hiérarchie est celle du code de la route, respectez-la.