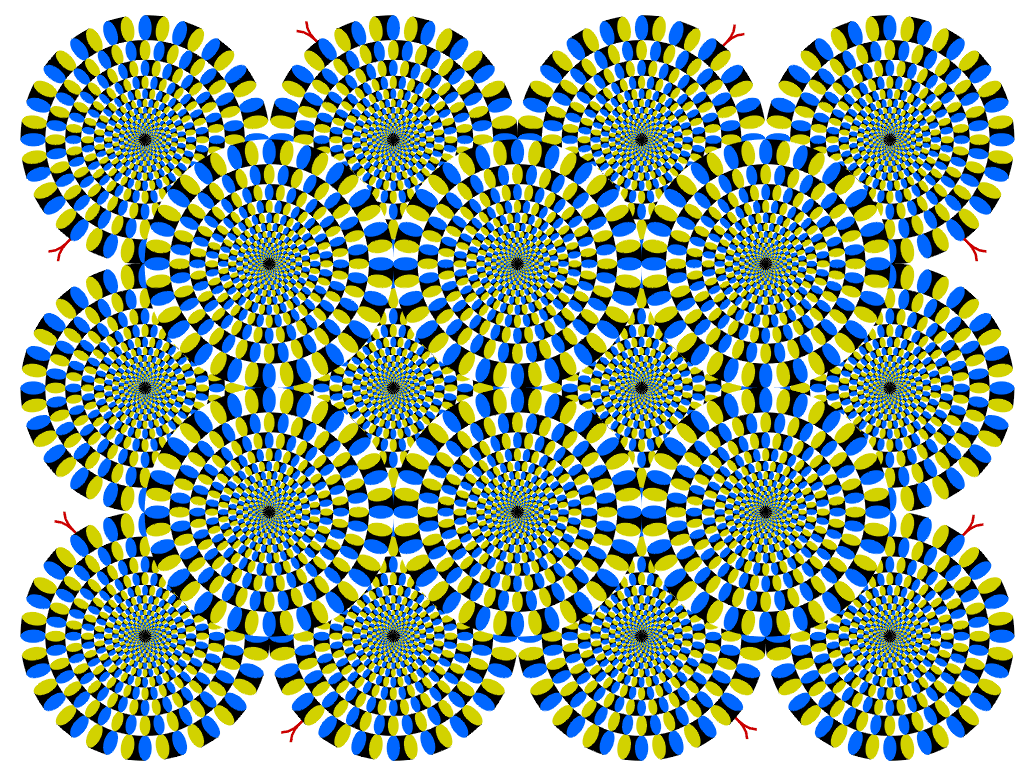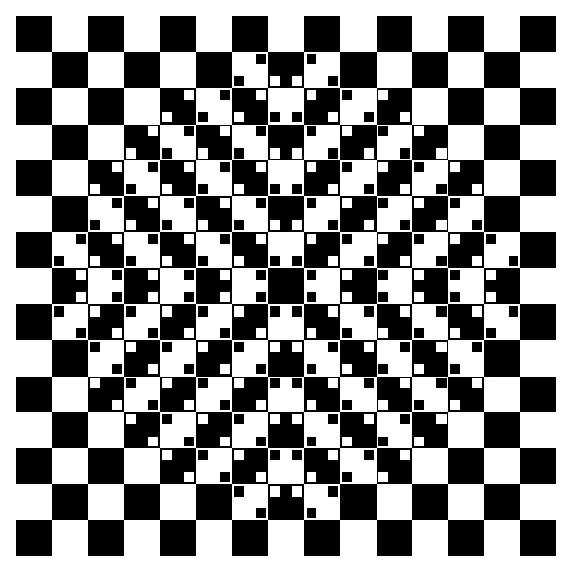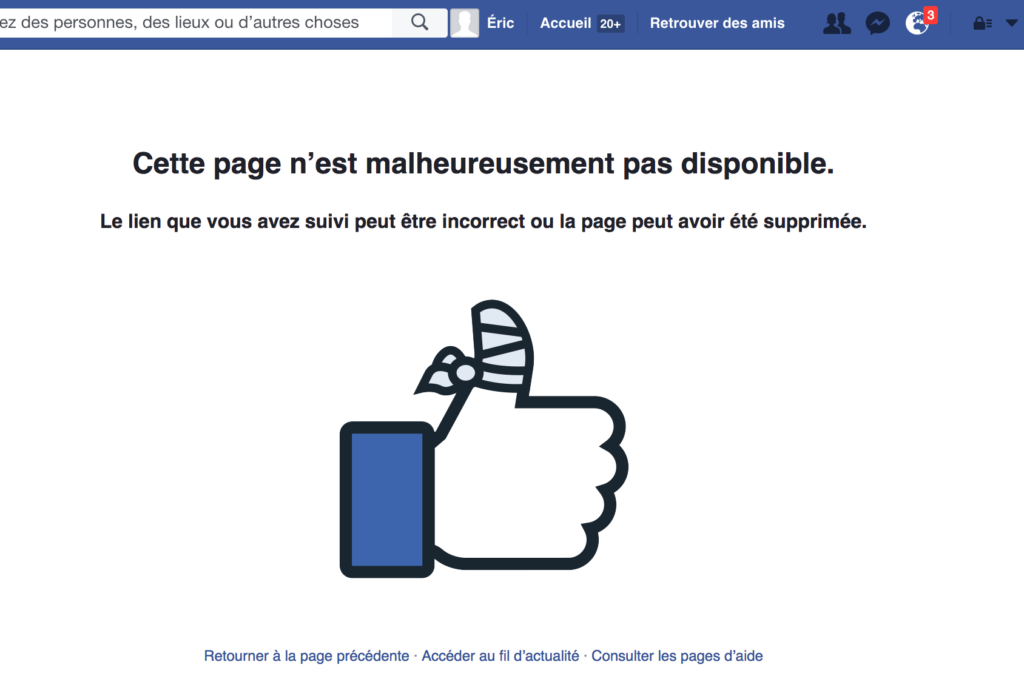Pour faire suite au billet précédent, pour répondre à une question Twitter, voilà ce que j’attends de mon lecteur RSS et comment je l’utilise. Pour facilement en discuter, j’ai numéroté les fonctions que j’utilise ou que j’aimerais voir.
L’utilisation de base
Quand j’ai envie j’ouvre Feedly pour voir ce qu’il y a de neuf. J’utilise la vue qui me donne la liste de tous les items non lus avec le nom de la source, le titre, et s’il y a de la place les premiers mots du contenu.
Là je décide ce que je veux lire ou non. J’en sélectionne probablement bien moins de 10%.
Parfois je les ouvre parfois directement (surtout les bandes dessinées, les photos et les billets politiques) mais je peux aussi envoyer le lien dans Pocket pour le lire plus tard. C’est particulièrement vrai pour les textes longs ou ceux qui n’ont qu’un extrait dans le flux RSS. C’est aussi fréquent quand je me prépare à une lecture offline (Feedly ne fonctionnant que online). À noter toutefois que j’envois plus de liens vers Pocket que je n’en dépile, donc ce que je ne lis pas immédiatement n’est parfois pas lu du tout.
Je le fais indifféremment sur desktop ou sur mobile, généralement de multiples fois par jour. Seule différence : Sur mobile j’ai tendance à envoyer directement dans Firefox mobile plutôt que via Pocket. Firefox est configuré pour juste empiler les liens et me les ouvrir comme nouveaux onglets la prochaine fois que je lance le navigateur.
Faire ce tri me prend quelques secondes tout au plus et je marque tout comme lu une fois que je suis arrivé à la fin de la liste.
J’ai donc cinq fonctionnalités indispensables :
- Un accès sur mobile Android et sur laptop Mac OS X, idéalement un accès web ;
- Une vue liste de tous les items non lus, tous flux confondus ;
- La possibilité d’envoyer vers Pocket pour lire plus tard ;
- Pouvoir tout marquer comme lu d’un seul coup ;
- La synchronisation des lus et non lus entre les différents appareils (pour Feedly c’est simple vu que toute manipulation est forcément online et synchrone).
La catégorisation
J’ai dans les 600 flux classés dans une dizaine de catégories. C’est une catégorisation floue, pas très stricte, mais ça fait le job. De toutes façons les sources elles-mêmes ne sont pas mono-sujet.
Je parcours rarement les items non lus catégorie par catégorie. Quand cela m’arrive c’est quasiment soit pour éviter la catégorie « photo » (quand il y a des gens derrière mon écran, parce qu’il y a des corps dénudés dans mes flux photo) soit pour éviter la catégorie « bandes dessinées » (parce que j’ai une bande passante pourrie et que je sais que ça va prendre des plombes, si jamais ça charge, et que je risque de marquer l’item comme lu sans avoir pu le lire).
À l’inverse, je parcours parfois une seule catégorie suivant mon humeur : « photo », « bandes dessinées » ou « dev web » (rarement les autres).
Si j’avais à refaire je remplacerai tout par moins de cinq catégories. Plus probablement, si j’avais une détection de contenu et la possibilité de filtrer « uniquement les contenus image/vidéo » et « uniquement les contenus texte » lors de la lecture (6), je ne sais pas si je continuerais à classer.
Sauf erreur, même quand il y a un flux par catégorie sur un blog, je ne segmente pas. Je suis le flux complet ou rien du tout.
L’ajout et le retrait
En général quand je rencontre un contenu sympa je vais voir les autres de la même source. Si j’ai un ratio signal/bruit suffisant, j’ajoute l’URL à mes flux. La fréquence de publication ne compte pas.
Si vraiment les publications sont trop fréquentes (je parle de dizaines d’items par jour), je retirerai le flux de Feedly dans la semaine. Par contre, pour peu qu’il tienne une semaine, il y restera probablement à vie.
J’utilise quasiment toujours l’auto-détection du flux RSS (7), c’est à dire que je pose dans mon flux l’adresse du site web et il me propose lui-même les flux correspondants.
Par contre je peste contre ces nouveaux services qui ne proposent pas de flux RSS. Facebook et Instagram je pense à vous, mais il y en a d’autres. Liferea a la possibilité d’exécuter des scripts pour convertir des pages ou des URL en flux RSS au moment de la mise à jour des flux mais ça reste du gros bidouillage qui tâche. J’aimerais que mon lecteur sache identifier les quelques services ultra-connus qui sont dans ce cas et qu’il s’en occupe tout seul (8), quitte à passer par un service tiers pour ça.
J’ai encore plein de flux qui ne publient quasiment plus rien, voire plus rien du tout. Je garde quand même parce que ça ne me coûte rien, et on en voit parfois qui revienne des années après. À chaque fois je me félicite de ne pas avoir fait le ménage.
Je n’ajoute que très rarement les RSS qui agrègent plusieurs blogs sur un même sujet. Je me retrouve avec des doublons ou dans l’impossibilité de faire la sélection. J’importe en général moi-même l’OPML. Je regrette d’ailleurs que Feedly ne soit pas capable de surveiller un OPML en ligne pour me proposer les nouveaux flux qui y sont ajoutés, voire pour les suivre automatiquement (9).
Petite particularité, quand je commente un billet ou que les commentaires m’intéressent et que le blog le permet, j’ajoute parfois le flux des commentaires du billet (mais celui du billet, pas celui de tous les commentaires du blog, qui est lui totalement inutile). Ça existe au moins sous Dotclear et Wordpress mais tous les thèmes ne mettent pas le lien dans la page. Franchement c’est super pratique et j’en veux à ceux qui ne le proposent pas ou qui ne présentent pas ce flux (Medium je pense à toi).
Ce qu’il me manque
Essentiellement sur Feedly il me manque une lecture hors-ligne sur mon mobile (avec bien entendu une synchronisation au retour de la connexion)(10). Dans l’idéal ça veut dire récupérer hors ligne aussi les images voire les vidéos, et pourquoi pas la page web liée quand le flux ne présente que des extraits (11).
Je ne l’utilise pas parce que c’est payant sous Feedly et que ça me semble cher pour ce que j’en ferais, mais j’aimerais bien pouvoir faire des recherches dans mes flux pour retrouver un lien qui est passé la veille ou même plusieurs mois avant (12). Ça veut dire rechercher sur le contenu (pas que le titre) et pouvoir ajouter des filtres pour la période de publication.
Si j’étais fou, j’aimerais bien que le lecteur RSS identifie tout seul les flux ou les items que j’ai tendance à ouvrir ou ne pas ouvrir, pour me mettre les plus intéressant en haut de liste, voire me proposer de supprimer les flux pour lesquels je n’ouvre jamais rien (13). Pour que ça fonctionne il faut toutefois qu’il repère quand j’ajoute le lien à Pocket et pas uniquement quand j’ouvre l’item directement.
Voilà pour la lecture RSS, qui reste mon outil principal. N’hésitez pas à proposer mieux que Feedly pour mon usage, je l’utilise un peu par défaut et faute d’avoir cherché mieux. Si j’ai le courage je fais un billet similaire pour Pocket et peut-être un pour Twitter, histoire que je fasse un panel complet des mes outils de lecture.
Et vous ? vous utilisez comment vos RSS ?