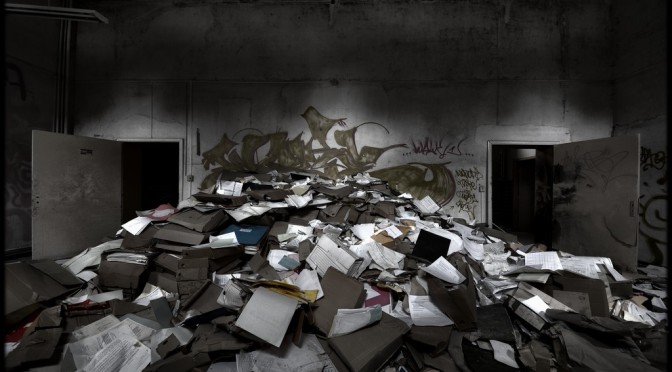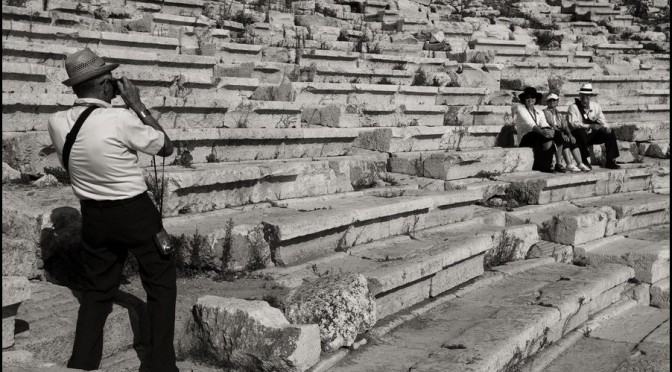Tous les textes ne sont pas des livres. C’est l’éditeur qui fait la littérature.
Mais surtout, on a besoin de cette médiation [de l’éditeur], pour se reconnaître, soi-même, comme auteur, et pour savoir que son texte est vraiment un livre.
Ah cette petite phrase de la Ministre de la Culture qui a fait coulé tant d’encre…
Certes l’idée exprimée a du sens et ne mérite pas le ridicule : Le regard de l’autre et la reconnaissance de l’autre font souvent partie du chemin pour reconnaitre la valeur de son propre travail, ou aident à le parcourir.
C’est pourtant aussi un symptôme plus profond. Il y a derrière une question de classe sociale et de reconnaissance sociale. Là prend tout son sens la notion de l’éditeur comme autorité établie pour faire la différence entre les auteurs et les Auteurs.
Il y a les vrais avec une majuscule et validés par un éditeur, puis il y a les autres qui écrivent aussi mais qu’on ne peut quand même pas considérer de la même façon. Chacun sa place ! L’idée transparait très bien dans les propos de Jean-Marie Cavada au parlement européen.
La hiérarchie entre les romans de gare et ce qui se veut grande littérature n’est pas si loin. Elle a juste changé de visage. Quand la notion d’auteur commence à intégrer un jugement sur le contenu, sur le mérite ou sur une échelle de reconnaissance, on ne parle plus de création culturelle mais d’ordre social.
Parti de cet axiome, on comprend bien mieux le niveau et la forme d’intervention publique dans la culture et la radicalisation systématique du droit d’auteur : Toute diffusion large ou peu chère est une atteinte à cette hiérarchie de classe, à ceux qui se voient au dessus ou à ceux qui valident cette structuration.
Le fait que le droit d’auteur profite aussi à tout un chacun est juste un effet de bord dans ce qui n’est finalement qu’une lutte des classes.
Si on parle de perte de valeur et d’encourager la création, on discute en réalité de domination et de sacralisation. C’est encore plus flagrant quand on regarde ces mêmes discussions en vue d’accords internationaux : Il y a ceux qui luttent pour créer et diffuser. En face il y a ceux qui luttent pour contrôler l’accès et la reconnaissance.
Je ne dis pas que cette façon de voir est consciente ou majoritaire, mais elle fait bien trop souvent surface depuis quelques temps parmi ceux qui finalement décident de orientations et équilibres de la création et du droit d’auteur. Les conséquences ne sont pas insignifiantes.