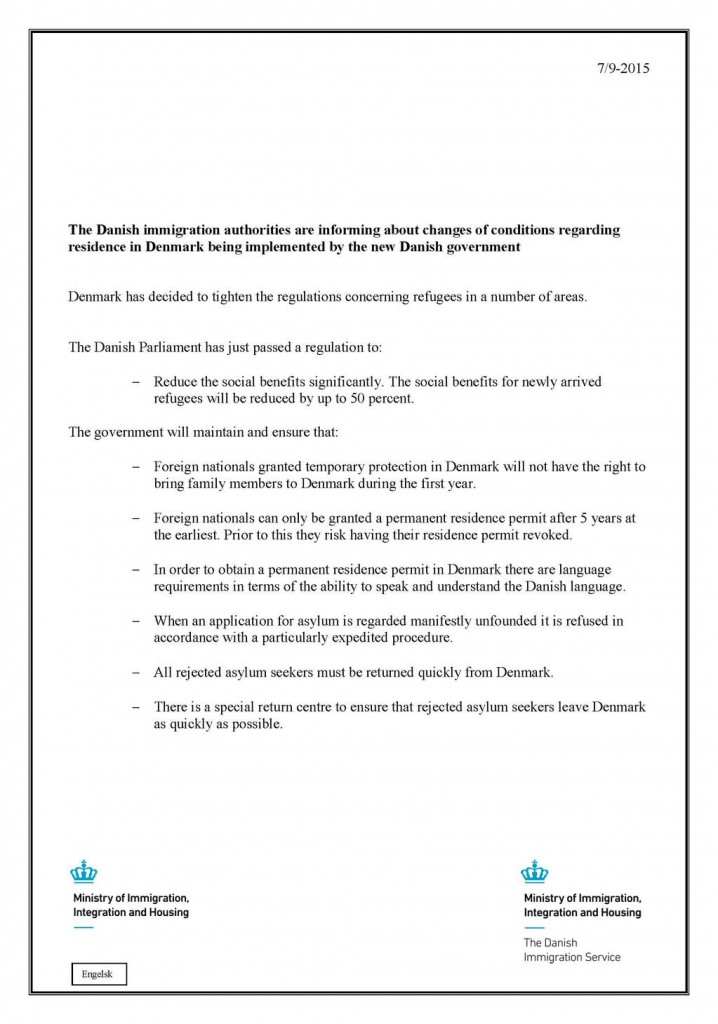Ce soir j’ai regardé la TV, en rattrapage. Un extrait de Cash Investigation faisait plus qu’interpeler. On y voyait que le système Parafe de contrôle biométrique aux frontières laissait finalement simplement les gens passer au bout d’un moment en cas d’échec du contrôle, sans intervention d’un agent.
Le pire c’est que ça s’insère très bien dans le schéma de cette politique sécuritaire spectacle, qui sert à montrer qu’on fait plutôt qu’à faire. Si ça rejetait vraiment des gens, ça deviendrait gênant, alors j’imagine très bien le réglage volontaire « au bout d’un moment on laisse passer », ou les gardes qui ne se déplacent pas en cas de signal d’échec, parce que passent par là les gens de la classe haute, qui s’y prêtent volontairement.
* * *
Il reste que les interviews me laissent un goût étrange. La journaliste ne lâche pas les morceaux. J’aime bien, surtout face à la complaisance des journalistes français. Mais derrière c’est le vide intersidéral. On n’analyse pas les réponses et on fait un montage qui ressemble à un scénario à charge.
Le responsable des frontières dit que le capteur des Parafe à été changé et que les paramètres ont été relevés. Ils n’arrivent pas à obtenir confirmation ou à avoir ce nouveau capteur. Étrangement là pas de nouveau test. J’en viens presque à me dire qu’ils ont tenté et échoué, mais que là on ne nous le montre pas. Ça mérite bien plus de temps d’antenne que les échecs de conversations téléphoniques pourtant.
* * *
J’ai lâché à l’interview de B. Hortefeux. Je déteste la personne, les idées. On lui montre que son rapport présente pile l’opposé de ses conclusions. Il refuse d’y croire mais surtout avance un argument : Il faudrait segmenter en fonction de la taille des villes, la situation est forcément différente.
Franchement, je n’ai pas le rapport d’origine, et encore moins les données segmentées qui ne semblent pas être dans le rapport présenté (ou alors ce serait vraiment de la mauvaise foi de la part de l’équipe de journalistes, et là c’est moi qui ne souhaite pas y croire, pas à ce point). Par contre que les résultats de criminalité et d’évolution de cette criminalité dépendent sérieusement du type et de la taille des villes, c’est quand même tout à fait crédible. Bref, on a tous les éléments pour un paradoxe de Simpson : Une donnée qui semble donner un résultat évident mais qui démontre l’inverse quand on trouve la bonne segmentation qui a du sens.
Peut-être est-ce une dérobade mais c’est crédible, ça mérite étude et sérieux. Le problème c’est que la journaliste ne lâche pas, ne semble même pas prendre en compte le retour, et le montage de l’interview renforce cet effet. Il arrête l’interview mais ça ne menait de toutes façons à rien qu’il ait raison ou tort. Au final sa réponse ne sera pas étudiée (ou pas dans ce qui parait à l’écran).
J’ai l’impression d’un débat tronqué et d’une vision simpliste, à charge, … de la part des journalistes. Quand je repense à la première partie, je vois que tout est monté ainsi, du début à la fin. Il y a des vrais problèmes levés, mais essentiellement du cash, trop peu d’investigation, ou alors ça ne transparait pas à l’écran. Dommage, du coup ça n’a plus grande crédibilité pour moi.