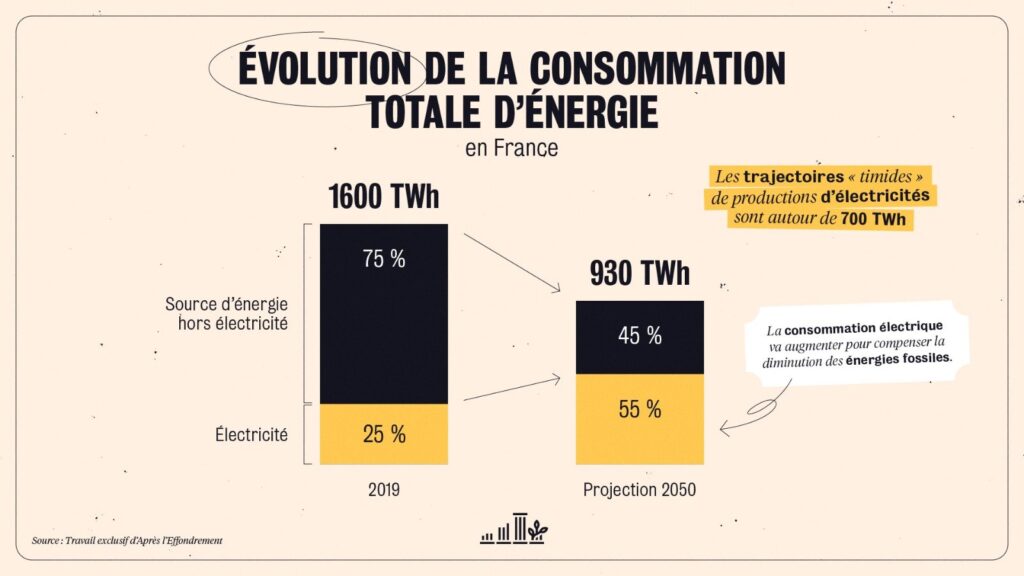Franchement on manque de courage pour changer des choses en France. Les solutions, des uns comme des autres, se bornent à des exonérations ou des règlementations à la marge.
Côté énergie on force le rachat de l’énergie produite par les panneaux solaires des particuliers à des tarifs qui génèrent plus un effet d’aubaine d’une réelle politique énergétique, surtout considérant la faible durée de vie des installations et le coût énergétique ou écologique de leur production. Le pire pour la politique énergétique c’est la transposition de la loi habituelle du marché : plus tu consommes, moins ça coûte cher.
Mediapart se fait en ce moment l’écho d’une proposition de loi sur des tarifs progressifs. Ce n’est pas la première fois qu’on en parle mais si vous n’avez pas d’avis tranché, la lecture donne un bon aperçu des problématiques. C’est en fait la simple application d’un système de bonus malus (équilibré, pas comme les subventions déguisées du domaine automobile) : ceux qui consomment beaucoup ont un malus, ceux qui consomment peu un bonus. Dit autrement c’est l’opposé de la situation actuelle : plus du consommes, plus ça coûte cher.
Chaque foyer se verrait attribuer un forfait de base, personnalisé, à l’aide de trois critères : lieu de vie, nombre de personnes du foyer et mode de chauffage. Il se situerait 3 à 10 % en dessous du niveau actuel. À chaque configuration possible, correspondent trois niveaux de bonus et de malus, qui recoupent trois niveaux de consommation : « basique », « confort » et « gaspillage ». Si l’on reste en deçà du basique, on touche un bonus. Si on le dépasse, on est bon pour un malus, voire un super malus.
On peut ergoter 100 ans sur les critères à ajouter ou à retirer, mais l’idée de base est bien la bonne : inciter plus fortement aux économies d’énergie. Les familles aisées aillant tendance à avoir plus d’appareils électriques, l’idée a même l’avantage de limiter l’effet « les pauvres vont payer les malus, n’ayant pas de quoi financer ce qu’il faut pour profiter des bonus ».
Certes, c’est forcément toujours imparfait. Il va être aussi très difficile de gérer l’équilibrage des quotas entre les différents modes de chauffage (est-ce qu’on privilégie l’électrique ou non ? le tout dépendant de la stratégie concernant le nucléaire) ou de savoir comment gérer avec intelligence le locataire qui subit la mauvaise isolation thermique du propriétaire.
Maintenant … si nous voulons avancer, il faut vraiment pousser nos politiques pour enfin un peu de courage et une vraie politique énergétique, avant que ce dossier soit abandonnés comme les autres un peu trop complexes ; surtout quand on voit que des pays sont prêts à abandonner ce types de réformes pour sauvegarder les bénéfices des fournisseurs. Avec les relations entre l’État, EDF et le nucléaire, ça risque de mal passer :
L’Allemagne en 2008 a étudié plusieurs modèles de tarification progressive, avant d’abandonner ce projet de réforme, estimant ne pas avoir trouvé la formule permettant à la fois de limiter les charges pour les ménages, et d’éviter les effets collatéraux sur les bénéfices des fournisseurs ou l’efficacité énergétique.