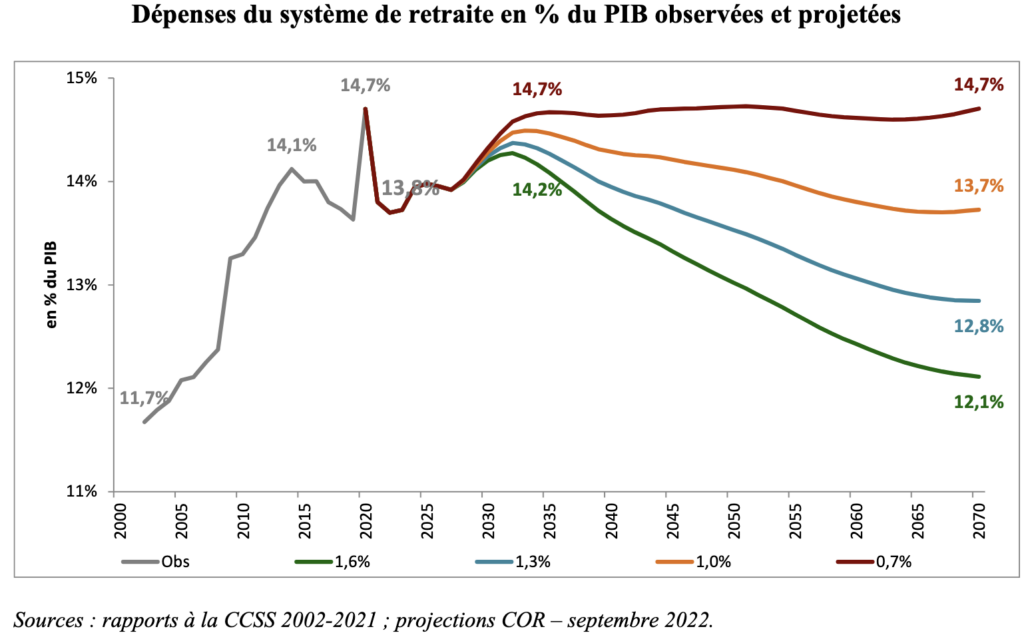Je continue ma prospection de matériel de voyage à vélo.
Je vise trois usages très distincts :
- La rando de 3 jours à 15 jours l’été 10 à 15° minimum, en France ou pays limitrophes
- La rando de 3 à 10 jours en intersaison à partir de mars jusque novembre, donc températures de nuit qui peuvent être négatives hors de la tente.
- L’expédition loin de 3 semaines à 3 mois, potentiellement jusqu’en Norvège.
Critères
Mon expérience se limite à un ancien matelas auto-gonflant Décathlon dit « ultralight » (mais finalement bien lourd par rapport aux options que je vais citer ici). Je dors habituellement sur le côté donc je vais faire attention à l’épaisseur et au confort du matelas. Le précédent était probablement le minimum que je m’autorise en terme de confort (j’étais jeune, je ne le suis plus autant).
L’isolation semble importante quand on descend sous les 10°C. Les vendeurs publient tous une mesure normée nommée R-Value alors ça se compare assez bien.
Au regard du poids, de l’isolation, du confort et des volumes, je pense partir sur du gonflable. Je sacrifie le prix, la résistance, et j’accepte de faire les 2 minutes de gonflage le soir.
La taille (?)
Je crois que la question principale est sur la taille. Je fais 180 cm. Les matelas en taille standard font 183 cm. Il faut vraiment être précis et ne pas bouger si on ne veut pas pas dépasser.
L’été on s’en moque un peu, on peut même prendre un matelas court de 120 cm et laisser les jambes sur le sol dur. L’hiver ça veut dire rompre l’isolation du matelas et casser celle du duvet, aux pieds alors que je n’y ai aucune circulation (j’en suis à dormir en chaussettes chaudes à la maison).
Pire : si je dors principalement sur le côté avec les genoux légèrement fléchis, je veux évidemment pouvoir étendre les jambes. Le truc c’est que ma position de repos aux pieds est inhabituelle, avec les pieds dans le prolongement des jambes (et pas à angle droit) donc je peux facilement m’étendre de nombreux cm de plus. Je me retrouve souvent les pieds dehors même sur un matelas « de maison » classique.
Bref, j’hésite à prendre un matelas long, généralement 196 cm. C’est plus lourd, ça soutiendra moins bien un gabarit intermédiaire comme le mien, et la largeur interdit les tentes où on se retrouve un peu serrés à plusieurs.
Je suis vraiment preneur de conseils : Taille standard ou taille longue ?
Épaisseur (?)
Je vais entre 85 et 90 kg. Je dors sur le côté. Je préfère le confort.
Je vois des 7 cm. Je ne prendrais probablement pas moins mais est-ce que les 10 cm ont un intérêt ?
Mousse + gonflable
La résistance des gonflables légers a l’air d’être quand même un vrai point faible.
Je vois passer l’astuce, pour ceux qui vont en températures basses, de doubler le gonflable avec un matelas mousse. Les R-Value s’additionnent et ça permet, au détriment du poids qui s’envole, de protéger le gonflable du sol tout en ayant toujours une isolation minimale s’il crève.
Bon, par contre tout ça sera beaucoup plus lourd et beaucoup plus volumineux qu’un simple matelas gonflable hiver sans la mousse. On parle quand même de 500 grammes de plus.
Sélection
Celui qui me semble le meilleur compromis c’est le Thermarest NeoAir XLite NXT. Il a un très bon R-Value de 4.5, reste encore très léger (350 grammes en standard, 470 en version longue et large), et à 7.6 cm ça devrait aller en confort.
L’idée c’est qu’il serve pour les trois types de voyages, éventuellement complété par une mousse pas chère pour améliorer l’isolation lors des voyages en températures négatives (mais je double le poids final).
En alternative :
- Si je veux plutôt le confort, j’ai le Sea to Summit Ether Light XT Insulated qui monte à 10 cm en épaisseur au prix de 140 grammes et d’une isolation moins bonne de R-3.2.
- Si je veux plutôt éviter un poids et un volume importants en expédition, je peux prendre le Thermarest NeoAir XTherm NXT et son isolation imbattable de R-7.3. J’évite la mousse l’hiver mais je perds la solution de secours si le matelas perce. Le surcoût n’est que de 100 grammes donc pas excessif même l’été où c’est superflu.
- Je peux aussi prendre un truc léger l’été, comme le Thermarest NeoAir Uberlite, et gagner au moins 100 grammes. Il me faudra alors un second matelas dédié à la saison froide (probablement le XTherm du coup).
Conseil et test
Je suis preneur de vos recommandations sur la longueur, l’épaisseur, les références, ou tout autre feedback qui vous parait pertinent. Si vous avez quelque chose de proche, je suis aussi preneur de pouvoir les tester sur Lyon si ça se révèle possible.